


| Auteur | Jean-Pierre Estival |
| Editeur | l'Harmattan |
| Date | 2025 |
| Pages | 252 |
| Sujets | Relations extérieures Afrique France Afrique francophone |
| Cote | 69.735 |
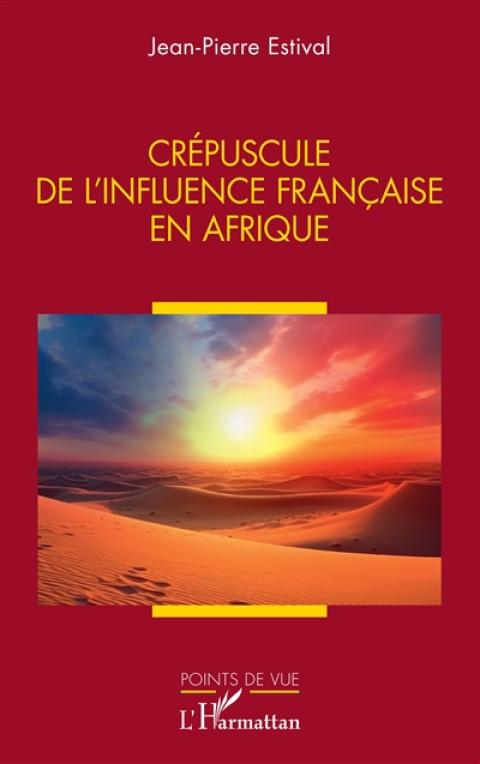
Le livre dont nous rendons compte est particulièrement intéressant, d’abord parce qu’il a été écrit tout récemment (imprimé en juillet 2025), puis parce que son auteur est un homme de terrain, ingénieur dans le domaine des transports terrestres. Son expérience de l’Afrique l’éloigne des diplomates, que leur position très privilégiée prive du contact avec les réalités quotidiennes des populations. Sa qualité le démarque aussi des universitaires, parfois trop amateurs des concepts et des livres.
M. Estival entend répondre à deux questions : dans quelle mesure l’influence française en Afrique a-t-elle reculé ? Pourquoi en est-on arrivé là ?
La mesure du recul de l’influence française
Plusieurs indicateurs sont utilisés par l’auteur.
* Ainsi, il constate l’effondrement du commerce entre la France et les pays africains. Les parts de marché sont allées à la Chine, de façon très majoritaire, mais aussi à la Turquie, à l’Iran, et même à l’Italie qui importe désormais le gaz algérien. Les grandes entreprises françaises n’obtiennent pas plus facilement des marchés que les autres entreprises étrangères, l’ère du pré carré est bien révolue. Et ces entreprises, grandes ou petites, ont massivement disparu du paysage, sauf au Gabon ou en Côte d’Ivoire.
* La présence militaire de la France en Afrique est largement étudiée. 18 000 hommes étaient présents sur le continent en 1960, au moment des indépendances. En 2014, ils n’étaient plus que 8 000. Aujourd’hui, il en reste en Côte d’Ivoire, pour peu de temps, 350 au Gabon, et 1500 à Djibouti, sur une base dont le bail est de plus en plus onéreux. L’expulsion de notre armée des pays du Sahel a été rapide et humiliante. En 2022, il faut quitter le Mali, l’année suivante c’est le tour du Burkina Faso et du Niger, ensuite c’est le Tchad, le Sénégal, et prochainement la Côte d’Ivoire.
La fin de la présence militaire française dans le Sahel n’était pas prévisible il y a seulement dix ans. A l’époque, les Etats sahéliens comptaient sur la France pour les délivrer de la menace djihadiste. L’opération Serval fut créée à cet effet en 2013 au profit du Mali. La même année, l’opération Sangaris était mise sur pied pour être déployée en Centrafrique, elle ne prendra fin qu’en 2016. En 2014, Barkhane prend le relais de Serval, mais de façon encore plus ambitieuse, puisqu’elle concerne, outre le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Elle durera sept ans.
La faiblesse des effectifs et l’immensité des territoires à contrôler expliquent que le djihadisme n’ait pas été éradiqué. Ce qui est présenté complaisamment comme un échec explique que plusieurs pays d’Afrique se soient tournés vers la Russie. A l’origine, le groupe Wagner s’installa au Mali, puis les troupes russes (Africa Corps) ont pris la succession de la milice de feu Evgueni Prigojine.
Il ne faut pas non plus oublier que nos militaires avaient le souci d’éviter des règlements de compte entre l’armée malienne, composée d’ethnies sudistes, et les Touaregs. Leur résistance aux militaires maliens suscita une hostilité chez ces derniers.
* L’abandon de nos bases militaires permanentes entraîne une perte certaine de notre influence diplomatique, dans la mesure où ces bases pouvaient dissuader certains de recourir à un soulèvement ou à un coup d’État.
L’effacement de notre influence diplomatique se constate également à l’ONU, lorsque l’on voit que depuis 2014 la Russie peut compter sur les voix des pays d’Afrique pour soutenir son action en Ukraine. Autrefois, du temps de la Françafrique de Foccart et de ses successeurs, ces voix étaient acquises à la France.
* Quatrième domaine où la perte d’influence de la France se constate, celui de la culture.
Depuis 2022, la langue française n’est plus enseignée dans les écoles primaires algériennes, l’anglais l’a remplacée. Et en 2023, les écoles privées se sont vues interdire l’enseignement du programme français. Le Rwanda de Kagamé avait, le premier, choisi l’anglais comme langue d’enseignement. Il a adhéré au Commonwealth en 2009, et en 2022 le Togo et le Gabon lui emboîtent le pas. En 2023, le français perd au Mali son statut de langue officielle. L’Algérie n’était déjà pas membre de l’OIF, mais maintenant la RDC envisage de quitter cette organisation. Or, ces deux pays représentent une part très importante des locuteurs francophones dans le monde.
L’explication du recul de l’influence française
La citation que l’auteur fait d’un apophtegme de Nietzsche constitue l’explication majeure de ce recul et le point d’appui des autres explications : « La faiblesse attire la haine ».
* L’incapacité de l’armée française à éradiquer le djihadisme au Sahel a été dévastatrice. L’armée prestigieuse de cette France, qui avait formé depuis 1960 les officiers et les sous-officiers des pays d’Afrique, et qui semblait si forte, n’est pas invincible ! Ce fut le coup de grâce, mais la haine contre la France était déjà ancienne et vive.
* La France n’est pas seulement faible, elle est également prédatrice. La longue, interminable, descente en flammes du franc CFA, « monnaie coloniale », est alimentée d’arguments économiques. Le franc CFA empêcherait les pays d’Afrique de diversifier leurs relations commerciales avec des pays autres que la France. Il priverait aussi les pays africains de leurs devises étrangères, puisqu’elles devraient les déposer auprès du Trésor français. Et l’on compare les pays qui utilisent le franc CFA avec les pays anglophones, qui se développeraient plus rapidement parce qu’ils ne seraient pas handicapés par ce prétendu frein au développement. L’auteur fait justice de ces accusations, et les balaie.
Remarquons en passant que Meloni utilise également des arguties, comme celle selon laquelle le franc CFA appauvrirait les pays d’Afrique, et serait responsable de l’émigration de ses habitants… Meloni ne craint pas, pour lutter contre cette immigration, de proposer un Plan Marshall pour l’Afrique. Elle n’invente rien, cela s’appelle la coopération, qui dure, en toute inefficacité, depuis soixante-cinq ans, voire quatre-vingts si l’on considère que le FIDES était un avant-goût des FAC. La duplicité du Premier ministre italien éclate aux yeux de tous lorsque l’on sait que l’immigration, qu’elle promettait de juguler, a fait un bond depuis son arrivée au pouvoir, et si elle a fait un bond c’est probablement parce que l’Italie vieillissante en a besoin. Et la disparition du franc CFA, pas plus qu’un nouveau Plan Marshall, ne changerait rien à cette situation.
L’Italie, qui achète maintenant le gaz algérien, a profité de notre éviction du Niger pour prendre en charge la formation des militaires de ce pays.
Puisque nous évoquons le Niger, il est bon de rappeler l’accusation, longtemps portée, de pillage de l’uranium par AREVA. C’est un thème récurrent que celui du pillage par la France des ressources naturelles de l’Afrique. La Russie n’était pas en reste, qui diffusait sur Internet des images de soldats hilares, couchés sur des lingots d’or, et qui étaient présentés comme des éléments de Barkhane qui, en réalité, exploiteraient des mines d’or. Ces sottises étaient prises au sérieux par toutes les couches de la population. J’ai souvenir de jeunes cadres moyens de la fonction publique (magistrats) qui me faisaient part de leur indignation en voyant ces images…
* Après la France faible et la France prédatrice, il y a la France puissance occupante. La présence de bases françaises dans plusieurs pays africains, puis la présence au Sahel pendant plusieurs années de troupes destinées à lutter contre le djihadisme, ont été perçues comme le maintien d’une armée d’occupation. Surtout par une jeunesse à la fois nationaliste et panafricaniste. Aussi cette jeunesse a-t-elle accueilli avec enthousiasme les récents coups d’État fomentés au Sahel par des militaires hostiles à la France.
Nos interventions en Côte d’Ivoire et en Libye ne sont pas à proprement parler des manifestations de note « armée d’occupation », mais elles renvoient à cette activité brutale et à la violation de la souveraineté de pays étrangers qui sont l’œuvre de notre armée. La destruction de la Libye, la déposition d’un chef d’État en exercice ont été très mal perçues.
* Enfin, quatrième cause de cette indigestion de la France que ressentent les Africains, la France est donneuse de leçons. On se rappelle le discours de Dakar de 2007, dans lequel Sarkozy affirmait que l’Afrique ne serait pas entrée dans l’histoire. Depuis, il y a eu les paroles de Macron qui, à Ouagadougou, envoyait son homologue Kaboré réparer la climatisation, à Kinshasa tenait publiquement des propos durs à Tshisekedi, et puis ailleurs reprochait aux pays du Sahel leur ingratitude envers la France qui aurait mis à leur service son armée pour les défendre contre le djihadisme. Sans oublier l’envoi à Yaoundé d’un ambassadeur du LGBTisme. Les messages sociétaux sans cesse ressassés de RFI ne rehaussent sans doute pas notre prestige auprès de populations dont les codes moraux restent très traditionnels.
Il ne faut pas s’étonner que les pays d’Afrique se tournent désormais vers des pays qui n’ont pas de passé colonial dans la région. La Russie, surtout, peut se prévaloir de son aide, du temps de l’URSS, aux mouvements de libération, et de son accueil de dizaines de milliers d’étudiants, dont certains sont encore aujourd’hui des cadres des pays africains.
Quant à la Chine, elle peut mettre en avant son travail dans la formation de la jeunesse, dans le domaine de la santé, dans la fourniture d’armes, ou dans le développement d’infrastructures routières et la construction de bâtiments publics.