


| Auteur | Antoine Fleyfel et Charbel Maalouf |
| Editeur | l'Harmattan |
| Date | 2024 |
| Pages | 190 |
| Sujets | Diasporas Chrétiens Emigration et immigration Histoire Chrétiens Moyen-Orient Histoire Actes de congrès |
| Cote | 69.512 |
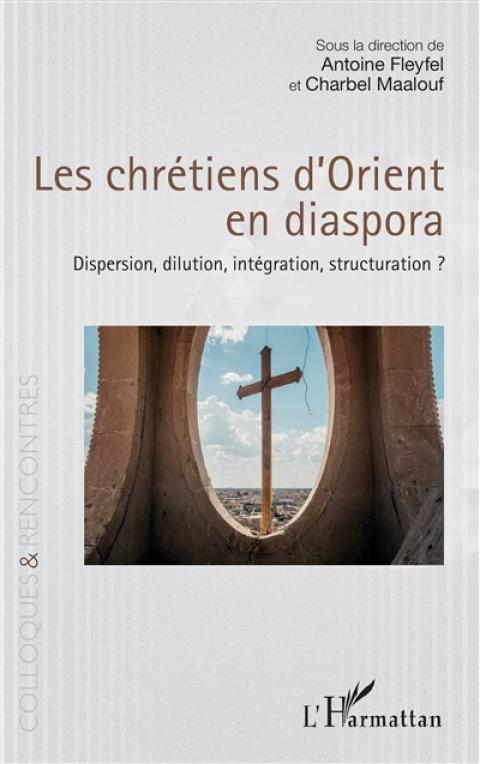
Cinq contributions évoquent les conditions générales dans lesquelles les chrétiens d’Orient en diaspora sont appelés à vivre leur religion.
Samir Arbache estime à environ cinq à six millions le nombre d’Arabes chrétiens qui vivent à l’étranger ; ils sont devenus presque aussi nombreux dans les diasporas que sur leurs terres ancestrales. Le slogan idéologique ancien « la langue arabe refuse de se christianiser » (p.51) persiste, alors qu’aux VIIIe et IXe siècles une littérature religieuse en arabe allait de pair avec l’arabisation de la société et que les textes arabes des Évangiles se diffusaient en même temps que le texte coranique. Constamment, un discours fondamentaliste musulman associe les chrétiens arabes aux croisés, donc à des adversaires (p.52). En émigrant en Europe qu’ils s’imaginent chrétienne, ils découvrent une société sécularisée, où le terme « arabe » signifie « musulman » (p.54). Néanmoins, en Europe, les Arabes chrétiens sont en mesure de transformer leur particularisme en atout en participant à l’avènement d’un humanisme familier du divin (p.56).
André Daher se demande quel est l’apport de l’Église maronite dans un Occident pluriel en quête de la vérité ? (p.166). L’émigration est perçue par les maronites comme une constante identitaire de leur Église et leur présence en Occident est ancienne (p.167). Actuellement, ils ont des diocèses aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Argentine, en Australie et en France (p.168) et sont renommés pour leur facilité d’intégration dans les pays d’accueil (p.169). Pour Jean-Paul II, « L’Église doit apprendre à respirer à nouveau avec ses deux poumons, oriental et occidental » (p.172). Il importe alors aux maronites de la diaspora de partager les acquis de la théologie arabe pour une harmonie de la réflexion théologique chrétienne globale (p.176) et de permettre l’inculturation de la tradition maronite en Occident (p.189).
Pour Antoine Fleyfel, les chrétiens d’Orient seraient presque huit millions à vivre sur le continent américain, en Europe ou en Australie (p.71). Qui sont-ils et qu’apportent-ils ? (p.72). Au XIXe siècle, dans le cadre de leurs aspirations à l’égalité avec les musulmans, ils étaient en quête d’identités nouvelles comme la citoyenneté (p.73). Au XXe siècle, le Syrien Michel Aflaq fut un des fondateurs de l’idéologie du Baath. La Résistance palestinienne, tendance majeure du nationalisme arabe, fut représentée par Constantin Zureik ou Georges Habache fondateur du FPLP. Antoun Saadé fonda le Parti Populaire Syrien. La théologie aussi se fit également l’écho de la Nahda, la Renaissance arabe, avec Mgr. Georges Khodr ou le Père Youakim Moubarak (p.74). Les chrétiens d’Orient émigrent certes à la recherche de conditions de vie meilleures (p.77), mais ils sont aussi en mesure de participer au dialogue islamo-chrétien, au dialogue œcuménique et aux débats citoyens (p.82). La terre diasporique apparait comme celle d’une nouvelle inculturation (p.84).
Charbel Maalouf rappelle que dès les premiers siècles du christianisme, l’Église est construite et s’est répandue au pluriel (p.139). Le chrétien dans le monde vit dans une communauté particulière en même temps que dans la transcendance que cette communauté est appelée à vivre selon l’idéal chrétien (p.141). La catholicité ou universalité est en lien avec la diaspora menacée de dispersion et de fragmentation (p.152). L’Église se fonde sur l’articulation entre les Églises particulières qui révèlent le caractère immanent des chrétiens en séjour sur la terre et le caractère transcendant auquel sont appelés les chrétiens en tension vers l’eschaton (p. 153). L’évêque devient le référent de l’unité dans la mesure où il est uni au Christ (p.159). La communion qui caractérise l’Église primitive diasporique et catholique, prouve que les Églises locales tissaient des liens entre elles à travers les évêques, les prières les uns pour les autres, les actes de solidarité (p.161).
Joseph Maïla constate que le fait de l’érosion du christianisme oriental est une vérité d’évidence mais la migration n’est pas pour autant une disparition. Le Proche et le Moyen Orient sont, de fait, des terres de passage et de transition (p.12). Le départ des chrétiens d’Orient est un phénomène ancien, durable et substantiel (p.13). Il est souffrance quand la participation politique ne se fait pas et que l’insertion économique n’est pas là (p.14). Les Chrétiens d’Orient vivent dans l’altérité religieuse, ne se définissant que dans leurs conditions quotidiennes de vie avec leurs concitoyens musulmans (p.15). La montée de l’islamisme engendra une inégalité citoyenne, les chrétiens n’accédant plus aux fonctions administratives (p.23) et voyant leur vie et leur sécurité menacées (p.27). L’Église d’Orient doit entretenir sa mémoire et son message spirituels et les laisser s’épanouir dans les sociétés d’accueil (p.30).
Quatre autres contributions décrivent des régions d’émigration, celle des chrétiens d’Orient au Canada, d’Arméniens et de Grecs en Éthiopie, des Arméniens au Proche-Orient ou des Maronites à Lyon.
Sami Aoun évoque les chrétiens d’Orient au Canada, où la pluralité ethno-religieuse est un aspect essentiel constitutif de son identité nationale. Le sécularisme de cet État fédéral se manifeste par la séparation des institutions gouvernementales des institutions religieuses (p.120). Les nouvelles générations, catholiques particulièrement, « s’installent dans une ignorance tranquille de la question religieuse ». Au Québec, les décisions politiques sont souvent influencées par des considérations de neutralité religieuse comme l’interdiction des signes religieux ostentatoires (p.126). De ce fait, les élites cléricales et laïques des chrétiens d’Orient sont confrontées à des défis complexes pour rester fidèles à leurs convictions (p.135) d’autant plus que la question de l’islamisme violent se pose comme défi de taille pour le vivre ensemble (p.137).
Serge Dewel parle de l’immigration en Éthiopie d’Arméniens et de Grecs à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, lesquels furent des agents actifs du développement et de la modernisation entamés par le Négus Menilek (p.31). Les premiers migrants abordèrent la Corne de l’Afrique par Massawa ou Djibouti, ouvert en 1888. La construction, à partir de 1897 par la France du chemin de fer Djibouti-Addis Abeba attira de nombreux Grecs (p.38). En 1935, les Grecs devinrent la deuxième communauté étrangère résidant en Éthiopie (p.42). Grecs et Arméniens étaient perçus par les Éthiopiens comme une communion historico-spirituelle à laquelle ils participaient (p.44). La fanfare royale fut constituée avec des orphelins arméniens ramenés de Jérusalem par le Négus Haïlé Sélassié qui y était en pèlerinage (p.41). Addis a conservé un club arménien et une école grecque qui n’a plus que des élèves éthiopiens (p.46). Le lecteur appréciera la précieuse bibliogaphie de cette contribution (p.47).
Tigrane Yegavian rappelle que la seconde guerre du Haut Karabagh de 2020 et le nettoyage ethnique réalisé dans l’indifférence générale trois ans plus tard ont révélé les forces et les faiblesses de la diaspora arménienne (p.87). Plus puissant que le Saint-Siège d’Etchmiadzine demeuré en Arménie historique, le Patriarcat arménien de Constantinople aura joué un rôle majeur dans la construction identitaire nationale (p.89). L’épanouissement de la diaspora arménienne au Levant est dû au fait qu’une minorité chrétienne dans une société post-ottomane majoritairement musulmane n’était pas menacée de se diluer, parce que garantie dans la permanence dumillet qui régulait les relations entre Église et État et que l’exception libanaise permit l’affirmation d’une autonomie interne arménienne issue de Cilicie (p.94) avec sa presse (p.96), ses partis politiques (p.103). La guerre du Liban de 1975 à 1989 fera beaucoup souffrir les Arméniens et contribuera à leur expatriation. Néanmoins, la mission du catholicosat d’Antélias s’est poursuivie en redynamisant les diocèses américains et canadiens (p.117).
Michel Younès évoque la présence libanaise et maronite à Lyon qui est ancienne. En 1875, la Province jésuite de Lyon est à l’origine de l’Université Saint Joseph et en 1883 de l’École de médecine de Beyrouth (p.57). La paroisse maronite de Lyon (1980) cherche à garantir la conservation de l’identité et le lien avec le Liban (p.61). Comme à Paris et à Marseille, elle a pris le nom de Notre-Dame du Liban (p.61). En 1985, un jumelage est établi entre les diocèses d’Antélias et de Lyon (p.58). La communauté maronite réfléchit sur le fait de privilégier les Libanais qui ont envie de conserver les souvenirs d’autrefois ou les jeunes générations nées en France et qui ne sont pas à l’aise avec la langue arabe (p.66). Certaines orientations pastorales dépassent le niveau paroissial comme le choix de la langue, de la traduction des chants liturgiques ou d’une catéchèse adaptée à la spiritualité et à l’héritage maronite (p.67). En tout cas, les expériences des maronites aident les autres communautés à vivre l’expérience d’être en minorité sans complexe (p.68).