


| Auteur | Philippe Ducroquet, Jean-Paul Charvet ; cartographie Laura Margueritte |
| Editeur | du Rocher |
| Date | 2024 |
| Pages | 248 |
| Sujets | Aliments Approvisionnement 2000-.... Politique alimentaire 2000-.... Politique agricole 2000-.... Atlas |
| Cote | In-Folio 526 |
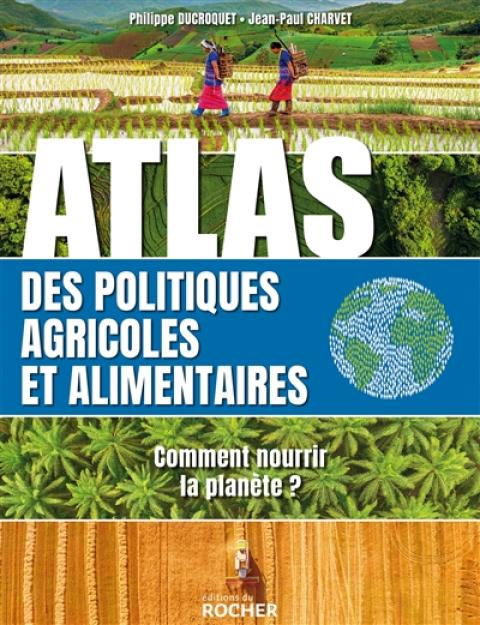
La faim dans le monde reculait depuis trois décennies. La malnutrition est repartie à la hausse depuis dix ans, malgré la progression globale de la production agricole. Comment nourrir en 2050 dix milliards de personnes ? C’est tout l’objet de l’Atlas des politiques agricoles et alimentaires dont les co-auteurs sont des experts de l’économie agricole, avec une longue pratique internationale du terrain.
Docteur en géographie de l’Université Toulouse-Le Mirail, diplômé d’Harvard Business School et titulaire d’une maîtrise en économie alimentaire de l’université du Massaschusetts, Philippe Ducroquet a dirigé des sociétés agro-alimentaires à l’étranger, notamment en Afrique, puis le groupe Unigrains.
Agrégé et docteur d’État en géographie, professeur honoraire à l’Université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, membre de l’Académie d’agriculture, Jean-Paul Charvet a publié de nombreux ouvrages, notamment L’alimentation dans le monde, mieux nourrir la planète (Larousse), L’agriculture mondialisée (La Documentation française), Atlas de l’agriculture (Flammarion-Autrement).
Dans un atlas très intéressant, accompagné de nombreuses cartes et d’une abondante iconographie, les co-auteurs étudient les facteurs qui conditionnent la réussite d’une agriculture performante, pouvant garantir aux populations la nourriture dont ils ont besoin, et aux États les moyens de la développer. Ils croisent pour chaque pays une batterie d’indicateurs et mesurent leur évolution sur une période de 60 ans : population ; sous-nutrition et facteurs d’augmentation de la demande alimentaire ; surfaces ; potentiel de progression des productions ; exportations/importations.
Une introduction très documentée sur la sécurité alimentaire dans le monde part des 17 objectifs de développement durable des Nations unies pour 2030, et propose une typologie, au niveau mondial, des modes de production, des politiques, agricoles, libérales ou protectionnistes, étudiées dans la durée avec leurs avantages et leurs excès, des contraintes climatiques, de la question centrale des ressources en eau.
Trente pays ont été sélectionnés, sur tous les continents. Algérie, Maroc, Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire, Nigeria, Éthiopie, Malawi, Zambie, Madagascar, Égypte, Turquie, Israël, Iran, Inde, Indonésie, Vietnam, Thaïlande, Chine, Japon, Russie, Ukraine, Cuba, Haïti,Brésil, Argentine, Australie, Canada, États-Unis, Union européenne. Pour chacun, l’atlas présente les caractéristiques de la géographie, du climat, des modes de production et analyse l’évolution des politiques, avec ses périodes charnières et ses ruptures.
Philippe Ducroquet et Jean-Paul Charvet relèvent la responsabilité des dirigeants politiques dans les échecs rencontrés (Madagascar, Zambie par exemple), aussi bien que les résultats positifs de politiques soutenant fortement l’agriculture (Israël, Plan Maroc Vert, Turquie). Certaines politiques agricoles ont une dimension géopolitique (Égypte). L’atlas met en valeur les initiatives heureuses venant du terrain et des organisations paysannes.
Les auteurs soulignent que l’Asie est le continent où la sous-nutrition a le plus reculé (Chine, Vietnam, Thaïlande). À la différence de l’Algérie, de l’Angola ou du Nigeria, l’Indonésie a su utiliser ses ressources en pétrole pour développer son agriculture et se comporter en État stratège. La Thaïlande n’a connu ni colonisation ni collectivisation et elle est devenue un grand pays agricole grâce à une politique libérale, accompagnée d’un fort investissement dans les infrastructures de proximité. L’atlas étudie les politiques des puissances agricoles latino-américaines et des grands pays agricoles du Nord.
Après avoir rencontré de très nombreux interlocuteurs dans les pays visités, agriculteurs, responsables professionnels, ministres, les deux auteurs énumèrent les conditions d’une politique agricole efficace, qu’elle soit libérale, protectionniste ou hybride. C’est ce qu’ils appellent « les huit prérequis » : une bonne gouvernance politique aux différents niveaux de l’État ; des infrastructures contribuant à freiner l’exode rural ( routes, écoles, hôpitaux, usines de transformation, la Thaïlande étant un bon exemple) ; une aide à la modernisation des techniques ( irrigation, engrais, produits phytosanitaires, car un potentiel physique favorable à la production agricole ne suffit pas, c’est par l’augmentation des rendements que la production peut être développée (Inde, Mexique, Malawi, Indonésie par exemple) ; les organisations paysannes (associations, syndicats, coopératives) dont l’absence explique les échecs de l’Éthiopie, de l’Algérie, du Mali, de Cuba, avant que ces pays ne changent de politique ; une organisation équilibrée des marchés ; la transformation de la production agricole sur place, encore très insuffisante en Afrique et en Amérique latine ; des moyens de l’État adéquats.
Il faut saluer cet ouvrage qui nous éclaire très utilement sur un sujet essentiel.