


| Auteur | Éric Thierry |
| Editeur | Les Indes savantes |
| Date | 2024 |
| Pages | 772 |
| Sujets | Québec (Canada ; province)-1500-1800 Champlain, Samuel de (1567?-1635) Biographie Canada Jusqu'à 1763 (Nouvelle-France) Découverte et exploration françaises |
| Cote | 69.174 |
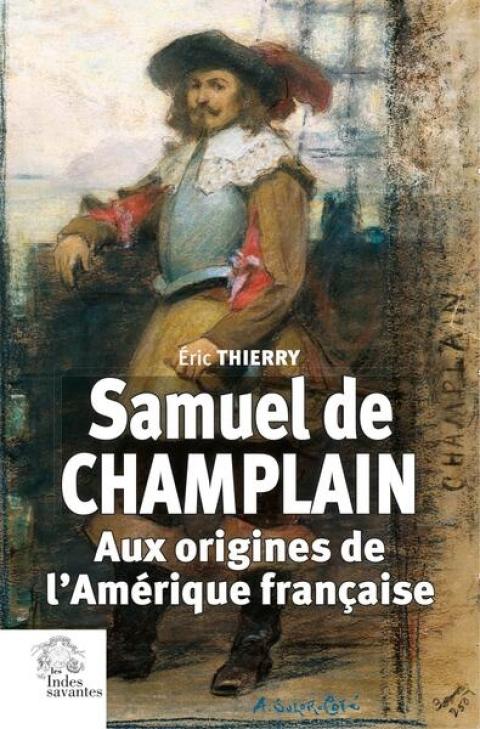
L’auteur Éric Thierry est un spécialiste de l’histoire de la Nouvelle France et des littératures de voyages. Il est l’auteur d’une biographie de Marc Lescarbot[1], (1570-1641), (Champion, 2001), de La France de Henri IV en Amérique du nord (Champion, 2008). Il a publié en 2019 les Œuvres complètes de Champlain (Septentrion).
L’Académie Française lui a décerné le prix Monseigneur Marcel en 2002[2] et le Prix du rayonnement de la langue et de la littérature française.
Aux origines de l’Amérique française est une somme de 30 années de travail : ce ne sont pas moins de 390 références pour une bibliographie conséquente qui traite aussi bien de sources manuscrites que l’auteur est allé rechercher au Canada, comme aux États-Unis mais aussi en France, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Les œuvres de Champlain, en édition originale, (4) publiées de son vivant ne sont pas oubliées ni les éditions critiques et autres sources.
Un index riche permet une recherche aisée, des cartes et illustrations permettent également de retracer les itinéraires et les lieux.
Espion dans l’Amérique espagnole, analyste à la cour de Henri IV, fondateur de la ville de Québec, explorateur de l’Acadie, de la Nouvelle Angleterre, de la vallée du Saint Laurent et de l’Ontario, père de la Nouvelle France, Samuel de Champlain (1567-1635) a consacré la plus grande partie de sa vie au développement de l’Amérique française où il arrive en 1603 avec un mandat d’exploration de la vallée du Saint Laurent : ce sera la découverte des nations amérindiennes, Montagnais, Micmacs, Echemins, Algonquins, Almouchiquois, Iroquois, Outaouais, Hurons. Adjoint du Chef des Français, il s’informe des mœurs et coutumes des amérindiens, découvre la traite déjà importante, les échanges entre produits européens, fourrures et poissons, les mines de cuivre et d’argent : c’est le premier récit de Champlain mais aussi la création d’une première compagnie pour le trafic de pelleterie et la pêcherie de baleines et de morues. Ce seront plusieurs tentatives de fondation d’installations, les espoirs déçus de l’île Sainte Croix(1604-1605), Fort Royal ou l’éphémère cité de Dieu (1605-1607) et la fondation de Québec (1607-1609).
Entre oppositions aux projets d’expansion outre-mer, intrigues de cour, ménagement des puissances européennes (Grande Bretagne, Provinces Unies, Espagne) dans une situation de relations internationales qui changent souvent au gré des alliances (ex. la guerre contre l’Espagne).
Constatant que l’économie de traite a ses limites, la décision est prise de développer une économie agricole capable de subvenir à ses besoins. Champlain est nommé Lieutenant ; ce sera le choix de Québec qui permet de verrouiller le Saint Laurent, où « il sera plus facile de planter la foi chrétienne, et d’établir un ordre, comme il est nécessaire pour la conservation d’un pays... ». Les contrats d’engagés sont signés pour deux ans, permettant le recrutement [3] d’ouvriers qualifiés, Québec est fondé.
Viendront ensuite la concurrence des traitants (chapitre 9), sur fond de dissensions entre nations amérindiennes, un nouveau départ, la publication d’un livre dans lequel Champlain privilégie les cartes, très précises. Le quatrième voyage sera imprimé en 1614. C’est aussi la période de conflits souvent intenses entre catholiques et protestants. Champlain œuvre à l’envoi de missionnaires, les récollets franciscains sont choisis de préférence aux jésuites, en écho à la bonne réputation d’efficacité dans les missions étrangères. Un séjour forcé en Huronie, les conflits avec la compagnie du Canada, 1616-1620 sur fond d’intrigues de cour, l’assassinat de Concini, l’emprisonnement du Prince de Condé vice-roi de la Nouvelle France. Champlain présente son projet d’évangélisation des Hurons, il est persuadé que la conversion des hurons, agriculteurs sédentaires, pourrait se faire par l’exemple, par l’entremise de colons laboureurs et artisans, qui seraient de parfaits chrétiens exprimant que la colonisation et l’évangélisation peuvent être menées de concert.
Le droit de Champlain de commander à Québec est contesté lorsqu’il s’embarque à nouveau pour la Nouvelle France en 1620, pour de nouveaux démêlés avec Guillaume de Caen dont la compagnie jouit d’un monopole du commerce de onze ans, l’autorité de Champlain sur l’habitation de Québec, les derniers chapitres renvoient à la prise de Québec (1626 -1629), la médisance des méchants, (1629-1632) et aux derniers espoirs pour Québec.
Les réseaux d’influence, les intérêts économiques en jeux, les rivalités politiques et religieuses, pèsent sur les décisions du roi. C’est la France de Henri IV et de Louis XIII marquée par les guerres de religions, par la révolte des Grands, les convoitises des puissances européennes, sur fond de conflits entre nations autochtones qui dessinent la trame du récit de Éric Thierry. Il nous fait vivre Samuel de Champlain, jeune cartographe des logis de l’Armée du Roi, observateur espion même, dessinateur de cartes, administrateur de colonies et explorateur décidé des possibilités offertes par le territoire gigantesque de la Nouvelle France, excellent gouverneur explorateur éprouvé, colonisateur déçu par l’ingratitude des puissants, artisan d’alliances avec les nations autochtones, devenu le bâtisseur d’une Amérique métissée.
Éric Thierry nous décrit un colonisateur paradoxal, chrétien humaniste qui croyait en l’humanité des amérindiens, et voyait agir en eux la grâce, qui rêvait d’une nouvelle France qui deviendrait la cité de Dieu, un de ces dévots dévoués à Dieu, et à leur prochain auquel la société québécoise doit certaines de ses valeurs bien vivantes comme son souci de l’ouverture aux autres et de la communion entre les hommes.
Dans son introduction, sous la plume du Père Le Jeune, contemporain de Champlain, l’auteur note que Champlain ne se révèle pas seulement avoir été un excellent gouverneur en ayant fait preuve de justice, d’équité et de fidélité à l’égard du roi et des associés de la Compagnie. Il a aussi été un parfait chrétien grâce à sa vertu et à sa piété. Mais le même Père le Jeune cite un Montagnais qui accuse Champlain et les jésuites de tuer une grand nombre d’autochtones avec leurs récits de voyages et des cartes… ; Champlain est donc un colonisateur aux multiples facettes : les avis divergent encore aujourd’hui, dans un magazine au Canada, Pierre Fortin, a proclamé Brillant arpenteur, cartographe, naturaliste et ethnographe, Champlain fut le premier scientifique de la Nouvelle France. D’autre part, Champlain « fut un vibrant promoteur de ce qu’on appelle aujourd’hui l’inter culturalisme, Comme Montaigne et Henri IV en France, il a rêvé d’un pays de coexistence et de paix entre les cultures et les religions. » A l’opposé, un autre auteur autochtone dans un journal ontarien se déchaîne, « Champlain était un homme méchant…Champlain était un meurtrier… Pour de nombreux peuples autochtones, Champlain représente le début d’une ère de perturbations, de maladies, de discrimination, de relocalisation, finalement d’oppression continue des droits de nos peuples. »
Le rêve de Champlain aurait-il été beaucoup plus géopolitique et économique qu’humaniste ?
« Champlain relève bien de l’héritage colonial du Canada. Comme colonisateur, il est rendu responsable des pires méfaits de la colonisation, il devient victime de la culpabilité par association ; c’est oublier que la discrimination et la relocalisation, c’est-à-dire la création de réserves pour les autochtones, sont plutôt dues à la colonisation de la Grande Bretagne, et même au Gouvernement fédéral canadien à l’origine de la loi sur les Indiens de 1876. »
Ainsi, l’œuvre de Champlain reste l’objet de vifs débats, en particulier son attitude face aux autochtones.
Au lecteur de s’interroger à la lecture de cet excellent ouvrage.
[1] Marc LESCARBOT[1], (1570-1641), érudit, avocat, voyageur, écrivain et courtisan (il parle latin, grec, hébreu). Avocat au Parlement de Paris il part de La Rochelle en 1606 pour séjourner en Acadie, à Port Royal, en Nouvelle France jusqu’en juillet 1607, avec ses compagnons, Louis HEBERT et Samuel de CHAMPLAIN, ex ligueurs, fervents catholiques ralliés à HENRI IV après sa conversion au christianisme ; imprégnés d’humanisme chrétien ils désiraient implanter en Acadie un christianisme des origines – une société sainte en quelque sorte-
[2] Le prix de la Fondation Monseigneur Marcel est un prix annuel de l’Académie Française, destiné à l’auteur d’un ouvrage consacré à l’histoire philosophique, littéraire, ou artistique, da la Renaissance (16ème siècle).
[3] Un bucheron, deux scieurs de long, sept charpentiers, deux maçons, deux serruriers, deux laboureurs, un jardinier et un tailleur d’habit !