


| Auteur | sous la direction d'Arnaud de Raulin et Aurélie Bayen-Poisson |
| Editeur | l’Harmattan |
| Date | 2025 |
| Pages | 318 |
| Sujets | Ecologie humaine-2000-.... Développement durable--2000-.... Ressources marines Exploitation-2000-.... |
| Cote |
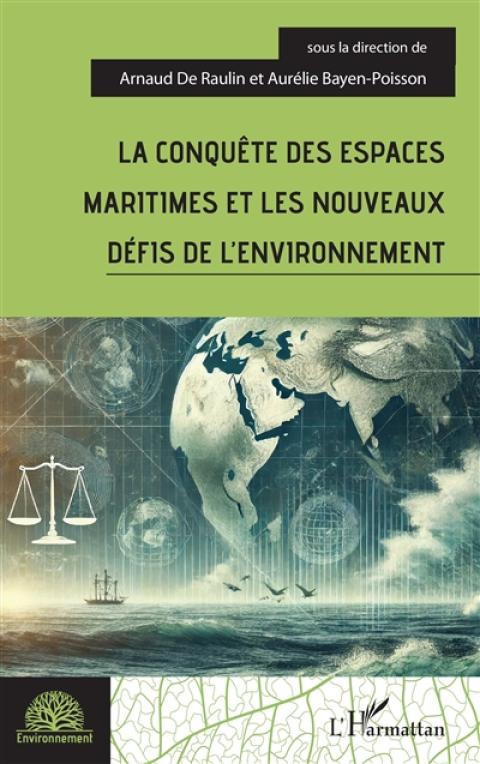
Les deux coordonnateurs de cet ouvrage, bien que de formation différente, droit public pour le premier, sociologie pour le second, n’en sont pas à leur première publication qui allie les deux disciplines. Ils ont conjointement ou séparément abordé les thèmes des espaces maritimes, de l’outre-mer français et de l’environnement. De surcroit, ils connaissent bien les territoires français du Pacifique pour avoir enseigné pendant plusieurs années à l’Université Catholique de l’Ouest (UCO Pacifique) à Papeete.
Dans leur préface, ils constatent que : « La crise actuelle relative à la gestion des mers représente plusieurs dimensions qui se conjuguent les unes aux autres ». L’approche classique, fondée sur la doctrine de l’anthropocentrisme, considère la prééminence de l’Homme dans les « affaires naturelles » comme primordiale. Or, un nouveau concept, celui de néo-anthropocentrisme, estime que l’évolution des espèces humaines ne peut être décorrélée des facteurs biochimiques et sociotechniques. Cette étude se propose d’une part, d’envisager la gestion de la biodiversité en faisant appel à la fois aux sciences vivantes et de la nature ; d’autre part, d’intégrer le point de vue géopolitique et juridique dans toute réflexion relative à l’exploitation des mers.
Dans une première partie intitulée « Le cadre structurel et les changements de paradigme », les contributeurs qui sont tous des professeurs de droit public, abordent des problématiques de leur compétence, comme l’appropriation et la marchandisation des espaces maritimes (Nathalie Ros), les changements climatiques et la submersion des îles du Pacifique (Hervé Raimana Lallemant-Moe), la réécriture du droit des sociétés océaniennes et un nouveau modèle pour les océans (Arnaud de Raulin).
Dans la seconde partie : « La gouvernance de la nature », les juristes abordent le sujet du patrimoine et de la gouvernance en Polynésie française (A. de Raulin), la biodiversité à l’épreuve des éoliennes (Marie-Charlotte Dizès) ; les trois autres sont plutôt consacrés à des sujets de sciences sociales : Te moana nui, l’océan des Polynésiens : représentations ancestrales de l’océan (Frédéric Torrente), Biodiversité marine et conscience écologique (Mathilde Maslin et A. Bayen-Poisson), et L’H2O en poésie (Hind Soudani).
Cet ouvrage arrive à point nommé, à l’heure où le sommet sur les océans de l’UNOC à Nice montre à quel point ces problématiques sont d’actualité.