


| Auteur | Didier Guignard |
| Editeur | CNRS |
| Date | 2025 |
| Pages | 661 |
| Sujets | Exploitations agricoles-Algérie-1870-1914 Exploitations agricoles-Algérie-20e siècle Conditions rurales-Algérie-1870-1914 Conditions rurales-Algérie-20e siècle Assassinat-Kabylie |
| Cote |
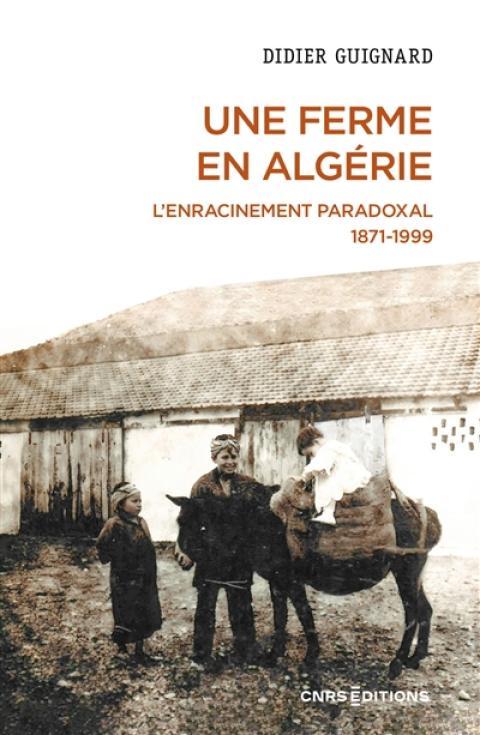
Il s’agit d’un livre très important, consacré à la manière dont une communauté rurale s’efforce de vivre la durée coloniale, puis postcoloniale, à travers son rapport à la terre dont elle a été dépouillée. Le cas étudié ici est celui de la ferme dite « Ferme Chartier », située à l’est d’Alger, établie sur des terres séquestrées au lendemain de l’insurrection de 1871 aux confins de la Grande-Kabylie. Sur une durée de plus d’un siècle, plusieurs temps se superposent : temps politique, temps économique, temps social. L’ensemble reconstitue le long terme de l’histoire agraire, avec ses réalités foncières et l’évolution de ses productions, notamment l’épisode viticole, ici relativement bref. Pour la période coloniale, l’auteur souligne les adaptations de la main-d’œuvre, d’abord musulmane, avec sa diversité, main-d’œuvre de journaliers, d’employés permanents, mais aussi de petits cadres indispensables à la direction du personnel. Il montre que les années qui suivent l’indépendance voient se succéder les bouleversements qui ne restituent pas la terre aux possesseurs originaux, mais, pour l’essentiel aboutissent à donner la primauté à de nouveaux exploitants, extérieurs à la région.
Le travail repose sur une vaste lecture d’archives classiques, mais aussi la constitution d’un corpus de témoignages familiaux, soit communiqués par écrit, soit obtenus à l’issue d’une enquête orale dans laquelle l’historien, truchement autant que médiateur grâce à sa maîtrise de l’arabe dialectal, a contribué à rapprocher les témoins musulmans et musulmans éloignés par les bouleversements de l’indépendance autant qu’à s’informer lui-même. Les travaux des historiens sur les questions agraires font l’objet d’une bibliographie très complète qui elle-même est l’objet d’une très intéressante réflexion historiographique.
L’ouvrage étudie sans préjugés comment les impératifs politiques, de la colonisation à l’indépendance en passant par la guerre, créent les conditions imposées dans laquelle les familles et les individus de toutes origines doivent assurer leur survie culturelle et matérielle. (ce que les Anglo-saxon désignent par le concept d’agency, popularisé par leurs épigones français). Les paysans ne s’écartent pas de la terre dont ils ont été dépossédés par la colonisation, adaptent leurs compétences aux demandes de l’agriculture européenne (vigne, céréales, élevage, y compris celui des porcs), cherchent à acquérir des propriétés voisines. L’indépendance n’est pas pour eux un moyen de rentrer dans des droits perdus un siècle plus tôt. Il faut s’adapter encore à l’autogestion qui est une nationalisation, puis voir une bourgeoisie certes de nationalité algérienne, mais étrangère au pays, lui succéder.
De leur côté, les propriétaires et exploitants européens établissent avec les autochtones une forme de « vivre ensemble ». Didier Guignard souligne la confiance entre employeurs européens et employés musulmans, établie sur la conscience très nette des limites à ne pas dépasser dans le respect de la dignité de chacun et de l’intérêt que trouve chacun à bien faire son travail. « Dans ces conditions, écrit-il, l’attachement sincère et réciproque entre les maîtres et leurs serviteurs n’a rien d’exceptionnel ». Les souvenirs rassemblés sur couple attachant des métayers, Camille et Margueritte, qu’il est impossible d’oublier, est mis en balance avec l’analyse du meurtre d’un ouvrier par un directeur de travaux, acquitté à l’issue d’un bref procès. Le compte-rendu qui dépasse toutes les prétendues « contre-enquêtes », retrace avec précision les conditions de l’enchaînement qui provoque un crime involontaire en réaction à un geste tout aussi involontaire. Plus loin, l’atmosphère de la guerre d’Algérie est remarquablement reconstituée, avec ses réalités quotidiennes, l’insécurité qui détache les européens, le poids des militaires. Les mois de l’indépendance méritent aussi une lecture approfondie.
On peut ici saluer un grand historien qui renouvelle en profondeur, à la fois par son sens du document et par sa sensibilité aux situations humaines, l’histoire de la colonisation en Algérie. C’est indiscutablement cet ouvrage qui mérite d’être récompensé par un prix de l’Académie.