


| Auteur | édités par Jean-Michel Mouton et Nicolas Grimal ; avant-propos Jean-Louis Oliver |
| Editeur | Académie des Inscriptions et Belles-Lettres |
| Date | 2025 |
| Pages | 548 |
| Sujets | Gestion des ressources en eau Asie Histoire Eau et civilisation Asie Histoire Actes de congrès |
| Cote | 69.567 |
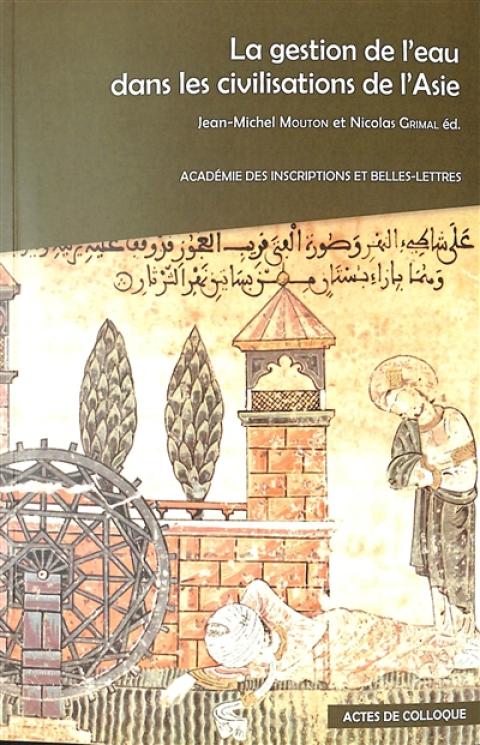
J.M. Mouton et N. Grimal présentent ce Colloque de deux jours, organisé avec l’Académie de l’Eau et la Société Asiatique et dont les 22 communications ont porté sur le délicat problème de la pénurie d’eau et de la multiplication des catastrophes climatiques (p.9). Plusieurs articles traitent des qanat, galeries drainantes du monde persan (p,11), d’autres des interactions entre l’eau, la société et les civilisations ou des usages de l’eau qui varient en fonction de la religion ou de la culture des populations concernées (p. 12). Le lecteur appréciera également la qualité et la précision de l’ensemble des illustrations et la richesse des bibliographies.
Pour l’Europe,J.C. Ducène, en examinant les cartes des fleuves d’Al Idrisi (vers 1154) en Espagne (p.19), en France (p.21), en Europe du Nord (p.22), Centrale ((p.24), Orientale (p.28), comme en Afrique (p.29) et en Asie (p.30) constate que le géographe n’en trace pas toujours le cours exact mais montre ainsi ses connaissances (p.34).
Pour le Moyen-Orient arabe,V. Matoïan, N. Jacob-Rousseau, R. Vallet et N. Ziegler traitent des politiques de l’eau de Sumer à nos jours en analysant les structures hydrauliques identifiées par des fouilles (p.43) menées dans les habitations privées et les espaces publics (p.52). Cette approche géostratégique apporte une contribution à la connaissance de l’environnement et de son évolution au cours des derniers siècles (p.54). La cartographie fait apparaitre la multiplicité des traces d’eau, ce qui sous-tend la réflexion et la prospective sur l’aménagement hydraulique (p.58).
L.Cez, R.Vallet, L.Darras, en étudiant l’approvisionnement et la gestion de l’eau à Larsa au IIe millénaire av. J.C, (p.67), constatent que l’importance des volumes d’eau stockées avait permis la mise en valeur agricole de toute la plaine au Nord de Larsa (p.84). L’ampleur et la haute technicité de ce dispositif révèlent un niveau de maîtrise en ingénierie hydraulique insoupçonné jusqu’ici (p.85).
R.Boucharlat se penche sur les origines des galeries d’eau souterraines qui proviennent soit d’un captage de l’eau à faible profondeur, soit de celui opéré dans un aquifère à plus grande profondeur (p.91). Les fouilles menées en Iran (p.96), en Égypte (p.98), dans les émirats d’Abou Dhabi (p.102) ou de Sharjah (p.104), montrent que ces galeries d’eau sont des solutions locales s’appuyant sur des captages peu profonds tandis que la technique du qanat dans un aquifère profond a permis le retour des galeries d’eau dans les zones arides (p.108).
E.Hibon analyse la gestion de l’eau en Gazîra, ou Haute Mésopotamie, arrosée par l’Euphrate et le Tigre aux XIIe et XIIIe siècles. Ces fleuves, contrairement au Nil, n’apportent pas l’eau dans le désert au moment le plus chaud (p.119). Les populations y héritaient d’anciennes installations qu’elles devaient entretenir (p.124). Les atabegs de Mossoul s’impliquèrent directement dans la répartition de l’eau (p.125), régie par les droits syriaque et musulman (p.129). Ibn Gubayr découvre à Tikrit une terre fertile et bénie (p.132). Ce paysage hydrique est la caractéristique principale de sa description de la Gazîra (p.134).
En Iran, pour J.C.Voisin, l’alimentation en eau des sites fortifiés de la Perse antique et médiévale s’est organisée à partir de citernes ou de retenues d’eau sur les reliefs et en plaine selon des puits donnant sur les qanat (p.142). Elle se fait aussi à partir de thalwegs fermés par un mur barrage dans les sites refuges (p.147). La couverture des citernes réduit les risques de développement des bactéries et protège des chutes de matières polluantes (p.154). L’imperméabilité des citernes était traitée par des enduits d’argile ou par du naphte (p.156). Ce sont les Sassanides qui auront mis en place une véritable gestion de l’eau (p.162).
J.P. Digard rappelle que l’Iran est un pays où l’eau revêt une importance primordiale (p.165). A partir de 2008, le gouvernement iranien a construit des usines de désalinisation (p.167). L’ingéniosité traditionnelle des Qanat est de ramener l’eau à la surface par une pente plus faible que l’inclinaison de la nappe, technique inscrite à l’inventaire du Patrimoine de l’Unesco en 2016 (p.168). L’eau est également utilisée dans les bassins-miroirs des jardins royaux comme au Palais des Quarante Colonnes à Ispahan (p.170).
En Asie Centrale, pour R. Rante, l’oasis de Boukhara n’est rien d’autre que le delta du Zerafshan qui prend sa source dans les Monts Alaï. C’est la seule source d’eau pour l’agriculture et les activités humaines (p.178). L’arrivée massive des populations hunniques au IIIe siècle puis des Turcs au VIe siècle généra des réaménagements du paysage encadrant le réseau hydrique. Au Xe siècle, la dynastie musulmane des Samanides marque la saturation de l’espace urbain de l’oasis (p.186). Le réseau hydrique subit des changements constants dans l’oasis comme à l’extérieur montrant que l’homme perpétue les mêmes pratiques depuis l’âge du bronze et façonne le territoire selon ses besoins (p.206).
C. Rhoné Quer traite de la façon dont les populations riveraines de l’Amou Darya mettent à profit les eaux du fleuve au début de l’islam, puis, au-delà de la seule irrigation, des autres usages du fleuve (p.216). Sa turbidité est attestée de longue date du fait des dépôts d’alluvions entre âge du bronze et âge du fer ainsi qu’aux déplacements de bancs de sable (p.220). D’où des eaux poissonneuses (p.224) et la culture de légumineuses dès l’antiquité (p.226). Mais l’irrégularité du débit de ce fleuve et la violence de ses crues en été empêchent l’installation au ras de l’eau (p.231).
En Inde, pour A.Houdas, les techniques hydrauliques développées dans la vallée de l’Indus au IIIe millénaire av. J. C. permettent de retracer l’histoire de la gestion de l’eau dans les civilisations d’Asie (p.240). Ainsi, la civilisation de l’Indus a pu constituer une société à dominante agraire (p.240), comme le montrent les structures hydrauliques urbaines découvertes dans les fouilles de plusieurs agglomérations (p.243) et la culture des sols par l’emploi d’outils aratoires (p.250). L’étude diachronique des techniques hydrauliques urbaines permet ainsi d’éclairer le processus d’apparition et de transformation des villes de l’Indus (p.260).
J. Levillain étudie la représentation de Vishnu couché sur les eaux de la mousson dans le cadre du paysage hydraulique de l’Inde centrale médiévale (p.275). Elle met en exergue ce qui lie cette divinité à l’eau et au cycle des âges cosmiques et sa capacité à assurer la transition entre un cycle de destruction et un cycle de recréation (p.285). Le bassin réservoir d’Ashapuri montre qu’une archéologie du rituel repose sur un corpus matériel et anépigraphe (p.295).
S.Singh remarque que les lacs de barrage constituent un type d’ouvrage hydraulique omniprésent en Inde (p.303), faisant partie intégrante de l’urbanisme médiéval et témoignant des pratiques urbaines culturelles de piété, de pèlerinage, de fertilité et de festivités axées sur l’eau (p.304).Ainsi, les ouvrages hydrauliques d’Udaypur témoignent d’un paradigme urbain, défini par une relation entre la ville, le temple et les dispositifs hydrauliques de l’arrière-pays agricole (p.321).
V. Kavali-Filliozat rappelant qu’une ville indienne doit avoir 3 étangs sacrés différents pour les activités religieuses, les besoins civils et les animaux, décrit la conservation et la consommation de l’eau dans la grande ville de Hampi-Vijayanagara entre 1346 et 1580 (p.335). Le palais et les habitations civiles y étaient bien approvisionnés en eau, d’autant plus que l’on croyait que le partage de l’eau d’un puits imposait le partage des péchés (p.144).
En Chine, Li Yuhang se penche sur la région tibétaine du Kham où prennent naissance les trois fleuves Yangzi, Jaune et Lancang. La gestion actuelle des ressources en eau s’y fonde sur les connaissances écologiques des habitants (p.349) qui ont lié une relation symbiotique avec la divinité de l’eau, les Klu.Néanmoins, pour l’État chinois, la science est présentée comme la panacée pour le problème du pastoralisme tibétain (p.367).
L. Longconstate que la maîtrise des eaux occupe une place fondamentale dans la mythologie et l’histoire de la Chine mais n’appartient pas aux écrits les plus anciens comme le montre l’étymologie de caractères liés à l’eau ou l’épigraphie antique (p.371). Sur plus de 150 000 pièces oraculaires inscrites découvertes à ce jour, seulement un millier se rapportent aux crues, aux cours d’eau et à la manière de conjurer leurs débordements (p.377). Les premiers grands chantiers hydrauliques commenceront avec les Qin et les Han (p.388).
S. Dmitriev présente un glossaire tangoute-chinois qui livre des données sur l’eau et sa gestion chez les Tangoutes qui comptaient des nomades et des agriculteurs aux conditions de vie difficile (p.377). Leur concept que « la terre c’est l’eau », paradoxal pour les Occidentaux, est une évidence pour ces habitants des déserts et des steppes (p.400).
Au Vietnam, pour O. Texier, l’aménagement du fleuve Rouge est fondé sur l’endiguement depuis deux millénaires par le peuple viêt. Ce processus de renforcement d’un réseau de digues de plus en plus complexe relevait directement, comme en Chine, des prérogatives régaliennes du monarque ; il structurait les rapports entre le pouvoir central et les collectivités paysannes d’autant plus que la production agricole constituait la plus importante source de revenus de l’État (p.405). La population devait également contribuer financièrement à la réparation des digues endommagées (p.414). Ces digues étaient publiques lorsque planifiées par l’État ou particulières si autofinancées par les collectivités locales (p.436) comme les digues littorales (p.455). Le contrôle de l’eau génère inévitablement des rapports de force entre pouvoir central et sociétés paysannes (p.466).
Dans les études comparatives,F. Delpech estime que dans la plupart des mythologies méditerranéennes et orientales, ce sont les dieux qui créent, libèrent ou dirigent l’eau et lui donnent une substance en tant que mer, lac, source, fleuve (p.471). Les personnages masculins monopolisent les fonctions du héros civilisateur hydraulicien, rarement attribuées à une femme (p.474). L’auteur a constaté l’existence d’une légende-type repérable dans plusieurs cultures de trois continents (p.475). Ainsi de la légende espagnole du XIIIe siècle de la princesse Liberia, héritière de royaume, exigeant d’un futur époux la construction d’un aqueduc, d’une cité et de routes (p.482). Cette légende est reprise chez des auteurs musulmans de la même époque (p.488) et dans le Ferhad et Chirin de Nizami qui évoque les rivières de vin, de lait et de miel (p.507). Les affinités avec le mythe de Sémiramis autorisent l’hypothèse d’une matrice proche-orientale remontant à l’antiquité (p.522).
J. Ganoulis admet que la relation dialectique entre l’homme et la nature est en constante évolution et marque le rapport entre eux selon 3 états, naturaliste, lorsque la nature domine l’homme, dualiste lorsque conflits et coopération sont en équilibre, anthropocentrique quand les hommes croient être capables de dominer la nature (p.532).
Il conviendrait plutôt d’adopter un modèle de comportement de l’homme envers la nature, fondé sur des observations scientifiques et préservant l’environnement (p.536).