


| Auteur | sous la direction de Dominique Barjot, Jeanne-Marie Amat-Roze et Jean-François Klein |
| Editeur | Maisonneuve & Larose |
| Date | 2024 |
| Pages | 590 |
| Sujets | Relations France Madagascar Madagascar La Réunion (France ; île) Forme ou Genre : Actes de congrès |
| Cote | 69.121 |
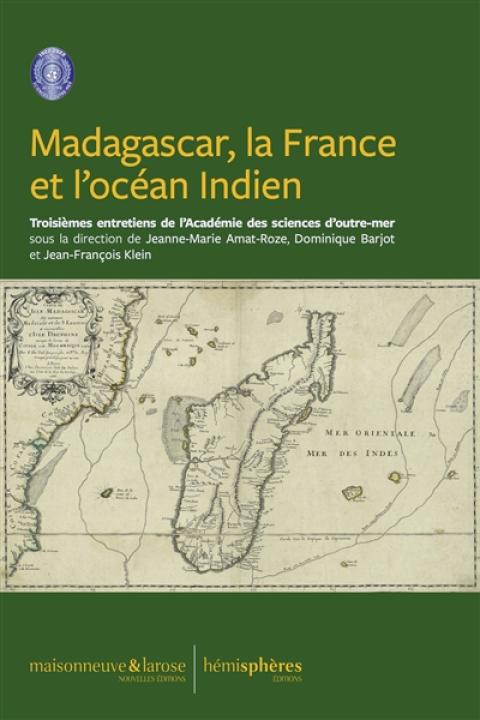
L’Océan Indien est une zone particulièrement importante aujourd’hui pour notre pays qui y a longtemps exercé une influence forte (ainsi à Madagascar, à Djibouti, aux Comores et même à l’Île Maurice, entre 1717 et 1814, sous le nom d’Île de France) et l’exerce encore, à travers sa souveraineté sur l’Île de La Réunion et Mayotte). Dans le cadre de son centenaire, l’Académie des sciences d’outre-mer (ASOM) a organisé du 17 mars au 2 avril 2023, les Troisièmes entretiens de l’outre-mer sur le thème « Madagascar, la France et l’Océan indien ». Il s’agissait à la fois de rendre hommage à l’Académie nationale des Arts, des lettres et des sciences de Madagascar (ou Akademia Malagasy), à la fois prestigieuse et plus ancienne que la nôtre, d’où la célébration à Paris, en 2002, du centenaire de l’Académie malgache, dans un esprit de totale parité, de renforcer nos liens avec l’Académie de l’ile de la Réunion, de favoriser les échanges de celle-ci et de l’Académie nationale Malgache. C’est pourquoi l’Académie des sciences d’outre-mer a souhaité conférer aux Troisièmes entretiens de l’outre-mer un caractère inter-académique.
Elle a émis le vœu que l’Académie nationale des arts, des lettres et des sciences de Madagascar soit pleinement associée à ces travaux, dans un esprit de partenariat équilibré et que cette association soit étendue à l’Académie de la Réunion, qui a manifesté son intérêt pour une collaboration étroite tant avec l’Académie malgache qu’avec celle des sciences d’outre-mer. Ce projet ambitieux, centré sur Madagascar et La Réunion, s’est élargi à l’ensemble indianocéanique et aboutit aujourd’hui à un ouvrage pluridisciplinaire. Il aborde des questions d’une grande variété et d’une vive actualité touchant à la fois aux héritages historiques, religieux et culturels, aux problématiques du développement soutenable (plutôt que durable), à la question des institutions et de l’exercice du pouvoir et, bien entendu, aux enjeux géostratégiques.
1 - UN AMBITIEUX PROJET
L’organisation a comporté l’organisation d’un important voyage d’études à Madagascar et à La Réunion, du 21 mars au 2 avril 2023[1], ainsi que la tenue de trois manifestations scientifiques[2] :
- à Paris, le 17 mars 2023, un colloque d’une journée à l’Académie des Sciences d’outre-mer, rue la Pérouse, autour de quatre axes majeurs de réflexion :
1 - histoire et historiographie ;
2 - les voies d’un développement durable : du développement économique au développement humain ;
3 - institutions, pouvoir et exercice du pouvoir : les perspectives institutionnelles ;
4 - les enjeux géostratégiques ;
- à Antananarivo, colloque d’une journée à l’académie nationale malgache, sur des thèmes définis en fonction des priorités de cette dernière. Ce colloque a été suivi d’un voyage d’étude de six jours (Antananarivo - Ambohimanga - Ambatolampy - Antsirabe - Ambositra - Ranomafana - Ambositra - Antananarivo). À Antananarivo, le séjour des représentants de l’Académie des sciences d’outre-mer s’est accompagné d’entretiens plus informels entre l’Académie nationale malgache et l’ASOM, notamment au cours d’un déjeuner organisé par la partie malgache.
- à Saint-Pierre de La Réunion, colloque d’une journée pour conclure les travaux et suivi d’une excursion au Piton de la Fournaise, d’une visite du domaine de Vallée, de la rhumerie Isautier et d’un circuit à travers Saint-Denis.
L’objet de l’ouvrage n’est évidemment pas de s’enfermer dans une stricte approche économique, même si celle-ci impose souvent sa dure réalité, comme le montrent les exemples de Madagascar, des Comores et même de Mayotte, mais aussi, quoique dans une moindre mesure, ceux de La Réunion et de Maurice. Il est au contraire de jouer des connaissances et des compétences interdisciplinaires qui caractérisent, à leur façon, chacune des trois Académies et des réseaux qu’elles sont susceptibles de mobiliser autour des diverses dimensions de la question. L’ouvrage s’ouvre, outre notre introduction, sur une préface de Louis Dominici, président de l’Académie des sciences d’outre-mer pour 2024 et diplomate de grande expérience internationale, et de Dominique Barjot, secrétaire perpétuel de cette même Académie depuis octobre 2023 et spécialiste d’histoire économique. Elle est accompagnée de textes des principaux initiateurs institutionnels du projet : Pierre Gény, docteur ès sciences, aujourd’hui décédé, qui fut secrétaire perpétuel jusqu’à l’élection de Dominique Barjot et à qui le présent livre doit tant, Roland Pourtier, président de l’ASOM pour 2023 et géographe éminent, François Rajaoson, président de l’Akademia Malagasy, membre associé de l’ASOM depuis 2023 et historien de grand renom, enfin Christian Landry, président de l’Académie de l’île de La Réunion.
L’introduction s’intéresse de près à l’économie malgache. Madagascar est aujourd'hui l'une des nations les plus pauvres du monde. Après l'indépendance, obtenue en 1960, l'économie malgache a poursuivi son développement sur la base de l'époque coloniale. Elle hérite alors de la politique de construction d'infrastructures par les autorités françaises et d’une économie de marché fondée sur les produits agricoles, les mines, le textile et le tourisme. Durant la présidence de Philibert Tsiranana, de 1960 à 1972, Madagascar connaît une croissance lente mais régulière du revenu par tête. Elle s’appuie à la fois sur l'aide publique et les capitaux français, mais aussi sur une politique agricole volontariste et un investissement marqué dans l'éducation.
Sous la Deuxième République, la crise politique des années 1972 à 1975, puis les choix collectivistes du président Didier Ratsiraka ouvrent la voie à une nouvelle crise plus globale puis à une longue dépression économique qu’aggravent ensuite les mesures d'ajustement structurel imposées par le FMI à partir de 1982. Depuis le départ de Ratsiraka et l'institution des Troisième et Quatrième Républiques, l'économie nationale ne parvient pas à retrouver la voie d'une croissance économique soutenable et régulière ni même son niveau de développement de la fin des années 1960. Cela s'explique par les graves crises survenues en 2001, 2009 et 2020-2021, cette dernière en raison de l'épidémie de COVID-19. Y concourent également la succession des catastrophes naturelles (cyclones, inondations, sécheresses), l'instabilité politique, la mauvaise gouvernance et la corruption.
Soumise à une croissance démographique forte, l'économie de Madagascar repose sur l'agriculture. Si le riz en constitue la première production agricole, le pays devient à partir de 1994 importateur net de riz asiatique, moins coûteux. De ce fait, la dépendance de Madagascar vis-à-vis de l'industrie minière se renforce. Quant au secteur de l'énergie, il présente les caractéristiques propres aux pays les moins avancés, avec, notamment, une domination écrasante de la biomasse. Cependant, à partir de 2002, le président Marc Ravalomanana ouvre le pays aux investissements étrangers et à l'essor du commerce extérieur. En dépit du lancement par le président Andry Rajoelina, en 2019-2023, du « Plan émergence », la situation économique de Madagascar demeure fragile. En effet, le pays se caractérise par un faible potentiel de croissance. Des réformes structurelles d'envergure sont nécessaires à une accélération significative et durable de la croissance à court, moyen et long terme. Il s’agit en effet de sortir d'une trop grande dépendance des secteurs prioritaires par rapport aux aides publiques et aux financements bilatéraux et multilatéraux émanant de bailleurs de fonds internationaux.
En contrepoint, La Réunion apparaît comme une économie développée. Avec quelques 26.389 dollars de PIB par tête en 2023 contre 530 pour Madagascar, son PIB total dépasse même celui de la Grande Île et de Maurice. Parmi les DROM-TOM, La Réunion est aussi l'économie la plus forte. Entre 1993 et 2007 par exemple, elle a connu la croissance la plus rapide de toutes les régions françaises. Néanmoins, son niveau de vie, s’il égale à peu près celui de la Martinique et de la Guadeloupe, demeure nettement inférieur à celui de la métropole. L'économie locale conserve l’empreinte de la canne à sucre. Celle-ci se maintient grâce aux aides de la France et de l'Union européenne. Elle fournit les trois quarts des exportations. La branche s'est modernisée et restructurée. Elle s'oriente vers de nouvelles productions comme le sucre de canne bio et l'utilisation de la canne à sucre en tant que combustible d’une centrale thermique. La Réunion exporte aussi le géranium, le vétiver, la vanille et le café, produits de moins en moins rentables à l'international. Ces cultures se trouvent néanmoins relancées par leur réorientation vers des productions à haute valeur ajoutée.
Néanmoins, l’autosuffisance alimentaire n'est pas atteinte. De plus, les prix connaissent des flambées spectaculaires après chaque cyclone. La production de viande comme de lait demeure trop faible tandis que la pêche n'occupe qu'une place mineure. De son côté, l'industrie ne fournit qu'un cinquième de la production de l'île. Elle repose pour l'essentiel sur l'agroalimentaire et le BTP mais contraint d'importer une grande partie de ses matériaux, d'où des coûts élevés. Le secteur tertiaire fournit à lui seul plus des trois quarts du PIB. Les secteurs les plus dynamiques concernent le commerce et, depuis les années 1980, le tourisme, malgré l'épidémie de chikungunya de 2005 et 2006 aux conséquences désastreuses. Les problèmes structurels subsistent avec un taux de chômage élevé, atteignant 25% en 2018. Ce chômage touche beaucoup les jeunes. 40% de la population vit par ailleurs en dessous du seuil de pauvreté, en raison de la cherté très forte des produits importés. Il en a résulté des mouvements récurrents de protestation contre la vie chère.
Aujourd'hui, l'économie réunionnaise montre des signes de résistance en dépit d'un contexte difficile : sortie de la crise de la COVID-19 et accélération de l'inflation consécutive à la guerre d'Ukraine. En 2022, le produit intérieur brut a enregistré une croissance supérieure à 7 %, se rapprochant ainsi de son niveau d’avant la crise sanitaire. Cette reprise est portée de façon égale par les consommations des ménages, des administrations publiques et les dépenses touristiques. En dépit du fléchissement de l'investissement et de l'inflation la plus élevée depuis trente ans, le pouvoir d'achat résiste soutenu à la fois par un emploi en expansion des hausses de salaires et des prestations sociales plus encore les créations d'entreprise s'accroissent beaucoup en 2022, atteignant un niveau record.
Le contraste est fort avec Mayotte, autre DROM français de l’Océan Indien. En 2023, l’île de Mayotte ne se place qu’au 5e rang des DROM quant au PIB par habitant. Ce PIB est majoritairement porté par la consommation finale des ménages et des administrations mais souffre d’une balance commerciale très déficitaire. Grâce à l'appui financier des fonds structurels de l'État français et de l'Union européenne, l'économie de l'île se caractérise par la dominance du secteur public. Son agriculture est destinée pour l’essentiel à l’autoconsommation. La pêche et l’aquaculture constituent des secteurs plus dynamiques mais pâtissent du manque d’infrastructures et de la domination par les intérêts métropolitains et espagnols sur la culture industrielle du thon. L’industrie y est plus développée, au contraire de l’artisanat. Son énergie lui provient de deux centrales thermiques et du solaire, dont la part décroît. Si le commerce constitue un secteur très dense et peu compétitif, le tourisme reste limité. L’île ne dispose donc pas des atouts suffisants pour faire face à une croissance démographique très forte et à l’afflux d’immigrants venus des Comores sur un territoire très densément peuplé.
Quant à l’Union des Comores, son niveau de vie est très faible. Son économie se caractérise par une croissance économique modeste, des déficits budgétaires et commerciaux élevés. Très mal classée au classement Doing Business, l’économie comorienne échange surtout avec l’UE, mais exporte vers l’Inde, Madagascar et les Émirats. Ces derniers sont le deuxième importateur derrière l’UE, mais devant le Pakistan et la Chine. Un quart de la population au moins y vit sous le seuil de pauvreté et le pays figure seulement au 152e rang mondial sur 189 pays en terme d’Indice de développement humain (IDH). L’agriculture représente encore 32% du PIB, contre 12% pour l’industrie et 55% pour les services. Le pays, dont la dette extérieure est élevée, a obtenu en 2020 un moratoire de trois ans accordé par le Club de Paris. Victimes de la faible compétitivité de son agriculture et de l’impact de la guerre d’Ukraine, mais aussi d’un haut niveau de corruption, les Comores ne peuvent relever, même grâce aux revenus issus d’une nombreuse diaspora, le défi d’une croissance démographique forte, d’où l’émigration massive vers la France et Mayotte.
Maurice fait partie au contraire des bons élèves du développement. Depuis son indépendance du Royaume-Uni en 1968, Maurice a mué d’une économie agricole à faible revenu par tête à une autre au revenu élevé fondée sur le tourisme, le textile, le sucre et les services financiers, justifiant le qualificatif de « miracle mauricien ». Très dépendante du pétrole importé pour ses besoins énergétiques, Maurice a développé la biomasse et l’hydroélectricité, le solaire et l’éolien. Bénéficiant, selon la World Bank, du deuxième revenu par habitant le plus élevé d’Afrique, le pays doit son succès économique à quatre facteurs principaux : une libéralisation hétérodoxe favorisant une diversification des activités productives ; une stratégie de construction nationale fondée sur la concertation ; des institutions fortes et inclusives (réduction forte des inégalités de revenus entre 1980 et 2006, lutte affirmée contre la corruption ; un haut niveau d’investissement public équitable. Pays souvent cité comme modèle en matière de libre entreprise, Maurice tire avantage de la puissance de ses services financiers ainsi que de ses investissements précoces et massifs dans les nouvelles technologies de l’information. Pour Madagascar, mais aussi la France, Maurice est un partenaire incontournable dans l’Océan Indien.
L’ouvrage s’articule en quatre parties. La première partie du livre s’attèle à la dimension historique et historiographique. Introduite par D. Barjot, elle comporte neuf contributions de François Rajaoson, « La Nation malgache en devenir, ou l’originalité de la construction historique malgache », Philippe Beaujard, « Madagascar et l’Océan Indien (VIIIe-XVIe siècle) : la construction d’une périphérie du système-monde »,Béatrice Touchelay, « Des illusions des statistiques coloniales. Que nous disent les statistiques Malgaches pendant la période coloniale (1896-1960), que ne nous disent-elles pas, ou mal », Audrey Carotenuto, « Approche de la question des résistances serviles à l’île Bourbon (1750-1848) », Véronique Chaillou, « Migration de main-d’œuvre engagée et crises diplomatiques dans l'Océan indien occidental au XIXe siècle », Frédéric Garan et Pierre-Éric Fagéol, « La Réunion-Madagascar, une histoire connectée. Faut-il en finir avec les aires coloniales ? », Claude Mignard-Moy de Lacroix, « Le Domaine de Vallée 1816 à nos jours », Julie-Caroline Mathieu et Dominique Barjot (ASOM) : Une saga entrepreneuriale réunionnaise : les Isautier », enfin de Bearisoa Rakotoniainaet Lalasoa Rasaloarison, « La place des entreprises françaises dans l'économie malgache pendant la Première République (1958-1972) ».
Introduite par D. Barjot, la deuxième partie traite des voies d’un développement durable (ou plutôt soutenable). Elle s’articule en deux livres. Le premier, introduit par J. M. Amat-Roze, s’intitule « Une biodiversité originale et fragile ». Centré sur La Réunion, il comporte trois communications, celles de François Bart « La nature et les hommes à La Réunion », Philippe Mairine, « Itinéraire géologique et géomorphologique du massif du Piton de la Fournaise » et Nicole Crestey, « La biodiversité autour du Piton de la Fournaise », à quoi s’ajoute une première table ronde « La Réunion, terre de biodiversité et d'innovation scientifique », co-présidée par J. M. Amat-Roze et Sonia Ribes-Beaudemoulin et avec la participation de Sonia Ribes-Beaudemoulin, « présentation de la problématique », Vincent Boullet, « La Réunion, un patrimoine mondial de biodiversité, entre invasions biologiques et innovation économique », Valentin Duflot, « La Réunion, sentinelle du changement climatique », Violaine Dulau, « La campagne de suivi satellitaire des Baleines à bosse MIROMEN//(Migration Routes of Megaptera ovaeangliae) », et Gérard Collin, « Pitons, Cirques et Remparts : retour sur le projet d'inscription de La Réunion au Patrimoine mondial de l'UNESCO ». Le second livre porte, pour sa part, sur « voies, blocages et impasses du développement économique et social ». Portant sur des aspects que complètent la présente introduction, elle réunit sept chapitres. Ils sont l’œuvre de Roland Pourtier, « La démographie de Madagascar : une mise en comparaison internationale », Aina Razafiarison, « Explosion démographique à Madagascar : du capital humain au péril humain », Bearisoa Rakotoniainaet Lalasoa Rasaloarison, « Madagascar : réalités et limites du développement économique et social de 1958 à 1972 », François Pacquement, « Contribuer au développement dans un espace régional : histoire de l’AFD dans l’Océan Indien », Catherine Fournet-Guérin, « Vivre à Tananarive - Géographie du changement dans la capitale malgache », Jean-Michel Waschberger, « Pauvreté et bien-être à Antananarivo : le support de l’intégration sociale », et deJeanne-Marie Amat-Roze, « Le paludisme à Madagascar, à La Réunion et, au-delà, dans le Sud-Ouest de l’Océan Indien : un dialogue nature-société singulier ».
La troisième partie de l’ouvrage s’interroge sur « Institutions, pouvoirs et héritages ». Elle aussi comporte deux livres. Introduit par Jean du Bois de Gaudusson, le premier porte sur « Institutions, pouvoirs et exercice du pouvoir ». Il réunit cinq chapitres, œuvres respectivement de Jean du Bois de Gaudusson lui-même, « Retour sur les fokonolona[3],Denis-Alexandre Lahiniriko(Université d'Antananarivo) : Les structures politiques à Tananarive. Union, unanimisme et divisions partisanes dans la culture nationaliste (1945-1958) », Raymond Ranjeva,« Institutions publiques malgaches depuis l’indépendance : quelles leçons ? », Toavina Ralambomahay, « De la conception endémique du poste de Premier ministre à Madagascar » et Tsiory Razafindrabe, « Madagascar à l’épreuve des états d’exception. Les pouvoirs de crise depuis l’indépendance ».
Introduit à nouveau par D. Barjot, le second livre aborde la question des « héritages patrimoniaux et enjeux culturels ». Il le fait à travers quatre contributions, celles de Bruno Delmas et Isabelle Algrain, « Les travaux de l’Union académique internationale : l’exemple des publications des manuscrits malgaches des XIXe-XXe siècles », Frédéric Garan, « Le développement du tourisme à Madagascar durant la période coloniale », Irène Rabenoro, « Distance linguistique et culturelle, pauvreté et insularité : un triple défi pour les apprenants malgaches de langues européennes », Serge Henri Rodin, « De la représentation des facteurs culturants à Madagascar ». S’y ajoute une deuxième table ronde intitulée « La Réunion, île de mille parts ». Co-présidée par Raoul Lucas et François Bart, elle donne lieu aux interventions de R. Lucas, « La Réunion, île de mille parts : texte introductif », Daoudjee Amode-Ismaël, « Du Gujarat à La Réunion. Les Indo-musulmans appelés « z’Arabes » : migration, adaptation, intégration », Charlotte Rabesahala, « Dans l’Océan Indien des mouvements de populations aux dynamiques culturelles. Ile Bourbon/La Réunion : toponymie et résistance des esclaves au royaume marron de l’Intérieur (1663-1848) », Mgr Gilbert Aubry, « Créolie en Indianocéanie », R. Lucas, « Le défi réunionnais », le tout conclu par F. Bart.
La quatrième et dernière partie « Enjeux géostratégiques » nous plonge dans la grande actualité, à partir de questionnements qui ne remontent pas à aujourd’hui. Introduite par Frédéric Turpin, elle associe six articles correspondant chacun à un chapitre spécifique : ceux de Claude Prudhomme, « Les religions de l’Indiaocéanie : un état de la recherche », Tovonirina Rakotondrabe, « Malheur aux vainqueurs ? Le vécu du terrain de la conquête par les officiers coloniaux à Madagascar (mai à octobre 1895) », Paul Villatoux, « La question des Îles éparses », Dominique Guillemin et Jean Martinant de Préneuf, « La Marine nationale et l’Océan Indien depuis 1945 », Jean-François Klein, « Madagascar : relais stratégique sur les Nouvelles Routes maritimes de la soie ? » et du Colonel Laurent de Saint Blanquat, chef de corps au Régiment du Service militaire adapté de La Réunion, « Le RSMA-R : au service de la France pour la jeunesse réunionnaise. Le Service militaire adapté et sa mise en œuvre à La Réunion : genèse, organisation et fonctionnement, résultats ».
Cette partie se termine sur la troisième et dernière table ronde (chapitre 7 de la partie). Intitulée « Indianocéanie géopolitique et francophonie », elle s’est déroulée sous la présidence conjointede Wilfrid Bertile, animateur, et Marie-Sybille de Vienne (ASOM). Se succèdent quatre interventions, celles de Wilfrid Bertile, « présentation de la problématique », Bernard Salva, « La Réunion et le co-développement régional », Wilfrid Bertile, « La France, de l’Indianocéanie à l’Indopacifique : les enjeux géopolitiques de notre temps », à quoi Marie-Sybille de Vienne ajoute quelques remarques en guise de conclusion. L’ouvrage s’achève sur les réflexions conclusives, autour de « La Réunion et sa place dans l’océan Indien », d’une part d’Huguette Bello, présidente de la Région-Réunion, « Madagascar, la France et l’Océan Indien », et de Laurent Amar, Conseiller diplomatique du Préfet de La Réunion, « La Réunion et sa place dans l’Océan Indien », ainsi que sur « Les apports du voyage d’étude à Madagascar et à La Réunion (21 mars-2 avril 2023) », présentés par J. M. Amat-Roze et D. Barjot.
On l’aura compris, le livre s’il ne prétend pas clore le sujet, recèle une grande richesse d’informations, tout en présentant une grande variété d’approches et ouvrant de nouvelles pistes de réflexion et de recherche.
[1]Jeanne-Marie Amat-Roze, « Compte-rendu du déplacement de l’ASOM à Madagascar et à La Réunion 21 mars – 2 avril 2023 », Mondes et cultures. Bulletin de l’Académie des sciences d’outre-mer. Séances du 6 janvier au 15 décembre 2023, tome LXXXIII – 2023, p. 301-312.
[2]Dominique Barjot, « Troisièmes entretiens de l’outre-mer : Madagascar, la France et l’Océan Indien, une série de trois colloques scientifiques», Mondes et cultures, Ibidem, p. 313-317.
[3]Le fokonolona est une communauté villageoise du pays merina à Madagascar. Traditionnellement, le fokonolona (de foko, clan ou ethnie et olona personne, être humain) réunissait les membres d'un ou de plusieurs clans, résidant sur un territoire délimité.