


| Auteur | Guillaume Blanc |
| Editeur | CNRS |
| Date | 2025 |
| Pages | 202 |
| Sujets | Historiens 2000-.... -Histoire (discipline) 2000-.... Autobiographie Ego-histoire |
| Cote | 69.564 |
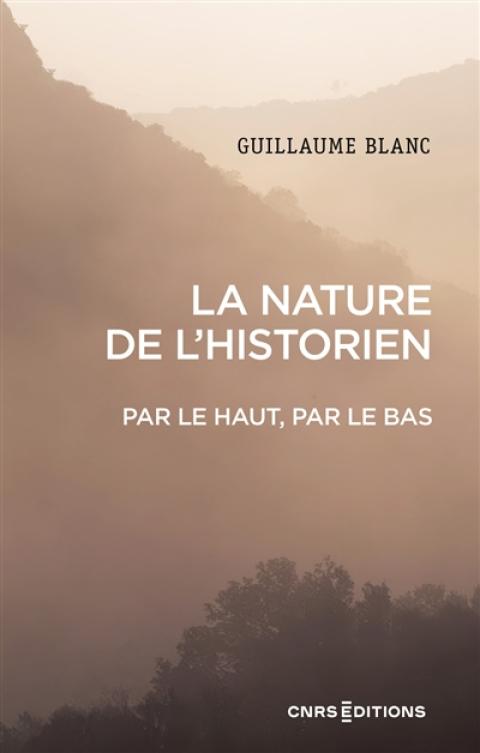
Ce livre, conçu comme un essai d’ego histoire, mêle approche personnelle, démarche intellectuelle et parcours universitaire, avec la préoccupation constante de montrer l’interaction entre les trois aspects. L’auteur a cherché autant que possible à présenter cette démarche avec la plus grande transparence, sans tomber dans le romanesque, avec une tension constante et authentique vers l’objectivité.
Le titre joue sur la dualité des sens. « La nature de l’historien », c’est d’abord la nature au sens écologique du terme, la physis comme objet saisi par l’historien Guillaume Blanc, à partir de son livre L’Invention du colonialisme vert, pour en finir avec le mythe de l’éden africain ; c’est aussi la manière dont le même historien se définit lui-même en tant que résultat de sa propre histoire.
« Par le haut, et par le bas » indique la nécessité d’une double approche de la matière historique, par le terrain autant qu’à travers les archives officielles mais aussi la manière dont l’historien se situe lui-même dans le monde social en sa qualité d’universitaire, loin des hautes ambitions du pouvoir et pourtant investi d’un certain pouvoir sur les étudiants et les chercheurs dont l’avenir dépend en partie de lui.
Le grand intérêt de ce livre est de donner à voir, à travers les éléments biographiques, le parcours d’un historien du temps présent qui dit beaucoup de ce qu’est le monde intellectuel français d’aujourd’hui. Sa vie a commencé dans un fait divers tragique qu’on laisse au lecteur le soin de découvrir et qui l’a marqué pour toujours. Enfant de petite classe moyenne française, non sans racines rurales, il a dû accomplir les sacrifices nécessaires pour atteindre la carrière universitaire. Ses études sont décousues et ne correspondent pas à l’itinéraire classique ou royal qui passe par les concours des Grandes Écoles et par l’Agrégation. Il a néanmoins bénéficié de l’accès à des établissements réputés, le Lycée Montaigne, puis la Sorbonne. Le monde dans lequel il vit est déjà pluriel, aussi bien dans son quartier parisien, marqué par la diversité, que dans celui qui va s’offrir à ses enquêtes. De ses révoltes de jeunesse, il garde le souvenir de quelques joints fumés dans son entourage et d’innombrables références musicales, notamment ces Têtes Raides, nés presque la même année que lui et dont le nom est tout un programme.
Sa formation est également influencée par l’ouverture sur le monde. Il a beaucoup voyagé, parfois à son compte, grâce à des « petits boulots » puis à l’aide de bourses mais dans des conditions sportives qui sont plus celles du grand reporter que de l’universitaire. Il vit dans un milieu dans lequel le partage du savoir est inséparable de la camaraderie et de l’amitié mais aussi d’une représentation commune du présent et de l’avenir de la cité. Ses engagements ne l’entraînent pas cependant à adhérer à un parti, comme ce fut le cas de toute la génération des promotions d’agrégés des années 1950.
Ses affinités le portent plutôt à privilégier le discours qui rejette les concepts race-classe-genre et se proclame partisan de l’intersectionnalité, « une approche qui vise à appréhender les relations de pouvoir à l’intersection des rapports sociaux de race, de classe et de genre » (p. 17). D’aucuns parleraient de « wokisme », si l’ouvrage ne révélait une ouverture d’esprit, un humour et une modestie dont le courant en question paraît totalement dépourvu ; si, d’autre part, la méthodologie qu’il illustre n’avait rien de systématique, tant il est vrai que, comme l’a souligné Pierre Bourdieu qu’il cite souvent, il y a loin de la théorie à la pratique, surtout en histoire qui se révèle, comme l’a écrit un autre grand homme « un art simple et tout d’exécution ».
Il est vrai que Guillaume Blanc ne croit guère à l’histoire comme science, ni même comme savoir objectif. Il voit dans le travail de l’historien une œuvre qui consiste à déconstruire les idées reçues, selon une lecture critique, plutôt que de conforter l’établissement de certitudes idéologiques imposées par les « dominants » pour le confort de leur situation. L’effort de déconstruction ainsi entendu vise à révéler la nature de l’action de l’État national, attaché à imposer aux sociétés une vision du passé dont on comprend qu’elle serait sclérosante et peut-être réactionnaire, plutôt que de les libérer dans une vision émancipatrice. Dans le cas précis de Guillaume Blanc, il s’est agi de montrer que les parcs nationaux ne sont pas une création désintéressée destinée à préserver la nature mais un message que les États (et les organisations internationales qui en émanent) ont voulu envoyer en construisant un paysage modelé en fonction de leurs conceptions, avec un choix des espèces retenues et, souvent, une disparition des populations qui vivaient sur les sols choisis.
Ces considérations valent aussi bien pour un parc naturel français comme les Cévennes, un parc canadien comme le parc Forillon au Québec et des parcs africains, notamment celui du Simien en Éthiopie. Guillaume Blanc souligne que ce dernier a été fondé dans un des rares pays africains à ne pas avoir connu une vraie colonisation, ce qui ne le différencie pourtant pas des parcs du Kenya ou d’Afrique du Sud, continués sans véritable rupture depuis les indépendances, constatation qui nourrit forcément une interrogation sur la notion féconde mais trop souvent piégée de « postcolonial ».
Ce monde n’est pas exempt de tensions permanentes et le grave accident dont Guillaume Blanc fut victime dans son enfance et qu’il nous décrit avec sensibilité et sobriété symbolise en quelque sorte la nécessité de se dégager constamment des contraintes du présent. L’historien doit tenter de faire passer son message sans le laisser déformer par des interprétations dans l’air du temps, ce qui n’est pas évident quand, ami de Patrick Boucheron et de Pascal Ory, on est accueilli par Eric Zemmour avec plus de bienveillance que par des journalistes de France-Inter. Il convient aussi de trouver le moyen de communiquer largement ses recherches au-delà des revues savantes, ce qui explique le choix, après un ensemble de publications académiques, d’avoir écrit le scénario d’une bande dessinée plus accessible au grand public.
Cette notoriété est inséparable de l’acquisition d’une place dans l’Université, avec ses parcours interminables et difficiles, ses passages multiples (dix-sept devant le CNRS, confesse Guillaume Blanc p. 65) devant des jurys aussi exigeants que fantaisistes ; une université où les luttes pour les positions de pouvoir, jamais absentes dans les générations précédentes, sont plus vives que jamais, même si les querelles de clercs peuvent paraître dérisoires par rapport aux enjeux mais où peut-être jamais les élections n’ont été moins ouvertes dès lors qu’elles sont aux mains de commissions dites ad hoc, préalablement triées sur le volet pour éviter toute mauvaise surprise ; une université enfin dans laquelle la recherche, la direction de travaux, les enseignements, la quête de financements cèdent le pas aux tâches d’administration moins utiles à faire progresser les savoirs qu’à justifier la présence des bureaucrates qui sont censés diriger l’institution et dont le but suggère Guillaume Blanc à la suite de Christophe Granger (qui sera difficile à démentir sur ce point) est la « destruction totale » de l’institution.
Derrière tous les aspects qui révèlent une sensibilité marquée par les influences culturelles du premier quart du XXIe siècle, Guillaume Blanc s’appuie sur une culture historique plus classique, acquise dans des établissements parisiens réputés déjà évoqués et dont témoignent ses références à Lucien Fèvre, Marc Bloch, Henri-Irénée Marrou, Maurice Agulhon, dans la lignée desquels il s’inscrit non sans quelque fierté secrète, quoique légitime. On pourrait seulement lui reprocher de négliger dans ses références l’école de Géographie française, tellement intéressée par la formation des paysages ou le recours à l’Antiquité et notamment à Aristophane, précurseur de l’intersectionnalité avec son Lysistrata (mais tout le monde n’a pas eu comme moi la chance d’avoir Victor-Henri Debidour comme professeur de grec).
Écrit d’une plume aisée, avec des convictions revendiquées mais sans prétention à détenir la vérité absolue, ce livre constitue un document de valeur sur l’historiographie française des années 2000-2025 et ses préoccupations méthodologiques. Tout historien authentique ne peut que souscrire à son affirmation : « Être historien, c’est chercher ce que dit l’histoire, mais aussi, je crois, s’efforcer de toujours mieux la raconter » (p. 13).
On finira cette recension par un clin d’œil : comment ne pas apprécier la remarque qui légitime une recherche sur l’histoire des Français d’Algérie (p. 165) alors qu’on est précisément en train d’écrire un livre sur ce sujet ?