


| Auteur | sous la direction de Claire Fredj, Nathalie Sage Pranchère et Jérôme van Wijland |
| Editeur | Presses Universitaires François-Rabelais |
| Date | 2024 |
| Pages | 416 |
| Sujets | Médecins étrangers Histoire 19e siècle Médecins À l'étranger Histoire 19e siècle Médecine Histoire |
| Cote | 69.065 |
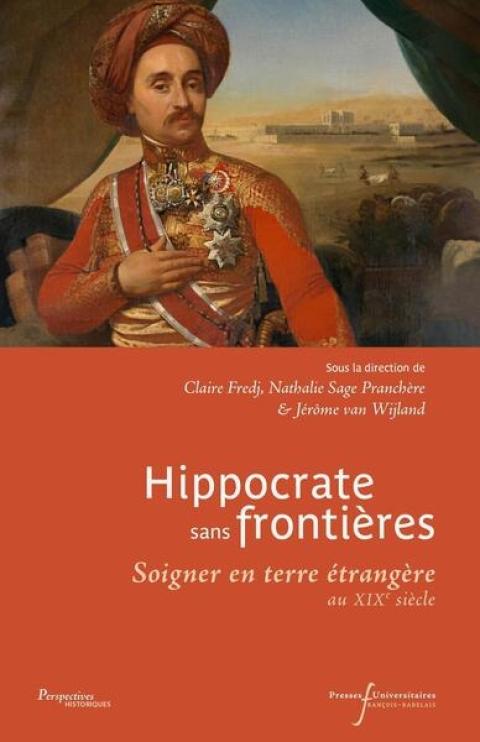
Prolongeant la circulation des savants dès l’antiquité, dans un but d’exercer leur profession ou d’apprendre au contact d’autres civilisations, le XIXe siècle marque un tournant. Souvent issus du monde des armées, les médecins français se rencontrent sous toutes les latitudes, se confrontant aux savoirs et aux pratiques médicales sur de nouveaux terrains. L’exercice de la médecine européenne à l’étranger développe des relations uniques avec le corps médical et les populations des pays, terres d’accueil de ces adeptes d’Hippocrate. Les pratiques professionnelles profitent de ces contacts et s’affinent de part et d’autre.
Cet ouvrage collectif qui réunit douze auteurs sous une direction collégiale, privilégie l’Europe, l’Amérique du sud et l’Extrême-Orient, choix lié aux recherches des auteurs retenus. Les aspects abordés sont variés.
Prenant une résonance toute particulière actuellement, la première partie est consacrée entièrement à l’accueil en France des médecins, diplômés à l’étranger. Si sous l’Ancien régime, les médecins étrangers sont peu tolérés, la Révolution française et les décennies qui suivent offrent une ouverture et une tolérance mais très encadrée. En dehors de la métropole, le cas de l’Algérie du XIXe siècle est traité grâce à l’apport du traitement des Archives nationales d’outre-mer.
La deuxième partie s’intéresse aux missions d’étude et aux corps expéditionnaires. Les auteurs illustrent ce thème à travers ces deux aspects. Le premier relève des missions d’étude ou des expérimentations, souvent sous tutelle du Ministère de l’intérieur, lancées dans la péninsule ibérique par exemple. On s’intéresse alors aux épidémies - la fièvre jaune, le choléra, le typhus, par exemple - et à leur propagation. La même politique est conduite au Proche et au Moyen-Orient mais souvent du fait seul des médecins nommés sur des assistances aux souverains régionaux. Ces missions sont souvent le cas d’opportunités de carrière, principalement en intégrant des commissions officielles ad hoc qui ouvrent les portes à de belles opportunités. Quant aux opérations militaires françaises à l’étranger, elles sont souvent l’occasion d’installer et de développer des hôpitaux, déjà réservés aux militaires français. Un chapitre est consacré à l’installation et aux péripéties de l’hôpital militaire du Pirée en Grèce.
Une troisième partie aborde la place et le rôle des médecins étrangers qui s’installent en France ou de la place des Français dans certains pays. Ainsi les relations entre la France et la Grèce suit le même schéma que celui de la France avec la Perse : la présence déterminante de médecins français en Grèce et le développement d’un enseignement, poussent les jeunes grecs à venir se perfectionner en France, voire à s’y établir et pour certains à y briller. Certains parmi eux repartent exercer leur profession dans les centres de la diaspora grecque en Europe, en Égypte ou dans les pays de leur naissance, comme l’Albanie, la Bulgarie, la Belgique, Chypre, le Turquie, l’Ukraine, et par là-même mettent en valeur leur formation acquise à Paris. Ils participent à l’influence française dans ces milieux scientifiques.
Enfin la quatrième partie passe au scalpel les itinéraires médicaux de certains médecins dans les colonies françaises de l’Extrême-Orient, tout comme la circulation d’étudiants indochinois et indiens en France et en Angleterre, profitant ainsi des possibilités des empires coloniaux. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que des facultés de médecine s’ouvrent dans les territoires de l’Empire. La propagation des épidémies, tel le choléra, dans tout l’Océan indien, encourage une grande mobilité de médecins européens et français qui tentent d’enrayer ces fléaux et leur propagation vers l’Europe ou l’Afrique. La carrière médicale sert alors de tremplin vers une certaine marche du pouvoir.
Cette partie se termine par une touche originale du médecin à l’étranger qui devient, du fait de son contact avec la population, un anthropologue, un psychologue, un agent du renseignement, une aide efficace de la biopolitique. Il participe à une meilleure connaissance de l’Autre. Le récit du docteur Jean-Jacques Matignon qui exerce à l’hôpital du Nan-Tang à Pékin, à la fin du siècle, annonce le développement des médecins-missionnaires des Affaires étrangères qui deviennent de véritables agents du renseignement dans la Chine de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle.
L’aspect abordé par cet ouvrage est loin d’avoir traité tous les axes de la coopération médicale et plus encore de la place de la médecine comme arme de l’influence et de la diplomatie françaises, à l’image des médecins militaires français en Perse, à la cour des souverains qui participent non seulement à l’étude des épidémies, à l’élaboration de programmes de prophylaxie mais qui installent une tradition de formation des futurs cadres médicaux iraniens en France, tradition qui s’est poursuivie jusqu’à la fin du XXe siècle. Le cas de la Moldavie abordé dans l’ouvrage rejoint cette problématique.
La matière est riche ; elle montre s’il en était besoin, combien la médecine française fut appréciée à travers le monde et comment le colonialisme, les conflits militaires, la diplomatie ont participé à cette image. Les services de médecine aux armées ont joué un rôle fondamental, ce qu’illustre abondamment cet ouvrage.