


| Auteur | Michel Bruneau |
| Editeur | l'Harmattan |
| Date | 2023 |
| Pages | 320 |
| Sujets | Bruneau, Michel (1940-....) Géographie (discipline) France 1970-.... Autobiographie |
| Cote | 69.019 |
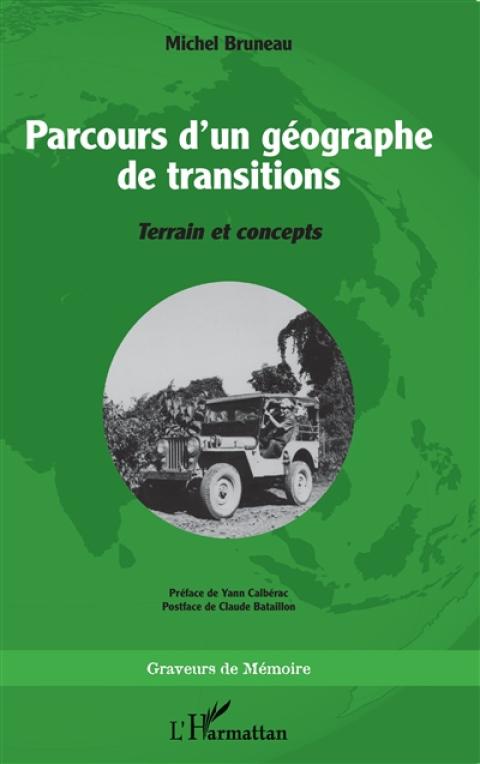
L’auteur, directeur de recherche émérite au CNRS, évoque l’objectif de ce livre qui est de montrer comment il a choisi très tôt la géographie et l’Asie du Sud-Est en fonction de son histoire familiale(p.23). Il ne s’agit pas, pour lui, d’écrire ses mémoires mais d’évoquer sa passion pour la géographie, son approche critique de la géographie tropicale et les combats qu’il a menés. Deux terrains, l’un en Thaïlande, l’autre dans la diaspora des Grecs pontiques lui auront permis de réaliser une œuvre de géographie (p.26), où la collecte des données joue un rôle essentiel (p.28). Il avoue aussi que son intérêt ressenti dès l’enfance pour l’exotisme du Tibet et de l’Asie Centrale venait de ses lectures des œuvres d’Alexandra David-Neel, de Fosco Maraini, du père Huc ou en écoutant les conférences d’Ella Maillart (p.41).
Après avoir passé l’agrégation de géographie en 1965, à la place du service militaire, l’auteur accomplit deux années de coopération en Thaïlande à Chiang Mai (p.47) comme lecteur à l’Université de cette ville située à 8OO km au nord de Bangkok (p.51). Il y apprend le thaï pour mener des enquêtes de terrain (p.53), aidé par ses étudiants pour les réponses à ses questionnaires destinés à une analyse informatique des données (p.62) et par les Pères de Bétharram établis dans les villages Karen (p.60). Son intégration au Centre d’Etudes de Géographie Tropicale de Bordeaux (CEGET) en mars 1971 lui permet d’exploiter ses données de terrain pour sa thèse (p.67). Il utilise l’analyse factuelle des données, la télédétection et les théories nouvelles issues de la sociologie, de l’anthropologie et de l’histoire (p.69). Il étudie l’inégale répartition des terres qui avait conduit les syndicats récents de paysans à revendiquer une réforme agraire (p.75). Les paysans sans terre se multipliaient alors que l’exode rural était peu développé. Des rapports de dépendance accrue augmentaient entre la petite paysannerie, les journaliers et les paysans aisés contrôlant la commercialisation, créant ainsi la lutte des classes (p.78).
L’auteur se réfère à son appartenance à la gauche, à ses lectures marxistes et maoïstes (p.33, p.79, p.87, p.109, p.115, p.130). La soutenance mouvementée de sa thèse en juin 1977, à Paris IV, est révélatrice des clivages à l 'époque dans la géographie tropicale, la géographie classique défendue par Pierre Gourou s’opposant à une géographie critique (p.71) et la plupart des membres du jury n’avaient pas apprécié ses innovations méthodologiques (p.100). Ces divisions idéologiques entre chercheurs dans les années 1968-1990 conduiront le CEGET à sa restructuration, évacuant sa dimension tropicale en 1993 (p.117).
Après la soutenance de sa thèse, les responsables académiques thaïlandais demanderont à M. Bruneau d’établir une cartographie agro-écologique du Nord-Est de leur pays (p.95). Puis l’auteur revisitera, en 2005, quatre des dix villages thaïs qu’il avait étudiés en 1966 et constatera que la tendance à la désintégration de la communauté rurale des années 1970 avait été surmontée par les mobilités et la diversification des activités non agricoles en lien avec l’urbanisation (p.141). Il reconnaitra que lui-même et les autres chercheurs n’avaient pas prévu une telle évolution (p.143 et 148). Il en conclura que la terre-patrimoine assure le transfert intergénérationnel et garantit un filet de sécurité en cas de crise (p.149). Il cite à ce propos notre confrère le Président Roland Pourtier (notice biographique p.69), qui ne doute pas de l’existence d’un monde tropical défini comme un système de systèmes articulant l’écosystème et la société (p. 131).
L’auteur renoue plus tard avec l’approche géo-historique en étudiant la diaspora grecque et l’hellénisme appréhendé dans sa longue durée (p.174) en reprenant des études d’hellénisme et de langue grecque moderne (p.177) avec le Pr. Georges Prévélakis de Paris IV (notice p.202). En 1922, à la suite du Traité de Lausanne, les Grecs pontiques furent expulsés de la province de Trébizonde, où ils résidaient sous l’Empire ottoman (p.205), vers la Macédoine (p.214), la Thrace (p.184), l’Abkhazie (p.185), où le Pr. Bruneau visite la capitale Sukhum dévastée en 1993 (photo p.190) et vers la Circassie (p.197). Il poursuit sa recherche entre 1990 et 2015 (p.233) des lieux de mémoire de ces réfugiés en Grèce en les comparant à ceux de la diaspora arménienne (p.208), en se rendant dans les villages abandonnés du Pont près de la frontière arménienne (p.213), en découvrant en 2015 des lettres d’un Français J.B. Miret ayant vécu à Smyrne avant 1922 et sa correspondance avec des amis d’enfance grecs exilés (p.230), en rencontrant les membres de la diaspora grecque à Sartrouville (p.226) et à Bordeaux (p. 228).
M. Bruneau nous assure que si le regard décolonial des chercheurs anglo-saxons inspiré par les critiques de l’orientalisme d’E.Saïd, de la tropicalité de P. Gourou et de ses successeurs avait été pour lui révélateur (p.132 et 174), le retour sur son terrain de thèse lui avait fait prendre conscience des limites de la géographie critique développée dans sa thèse (p.151) et que, pour rendre compte des inégales répartitions de la population et des richesses, il fallait faire appel aux modèles spatiaux anciens et aux logiques territoriales des États (p.166).
Le lecteur appréciera la postface de Claude Bataillon qui permet aux non-spécialistes de comprendre les affrontements des géographes sur le long terme, du colonial au développement (p.290), le tableau rappelant les composantes du terrain asiatique étudié (p.172), celui des Grecs pontiques en Asie Mineure (p.236), les cartes et les photos illustrant les différents chapitres, les références bibliographiques propres à l’auteur (p.271-272) et générales (p.197 à 218).