


| Auteur | Sylvain Mary |
| Editeur | Sorbonne Université Presses |
| Date | 2021 |
| Pages | 410 |
| Sujets | Postcolonialisme Décolonisation Antilles françaises Départementalisation Antilles françaises Politique et gouvernement Antilles françaises 1945-1990 |
| Cote | 65.254 |
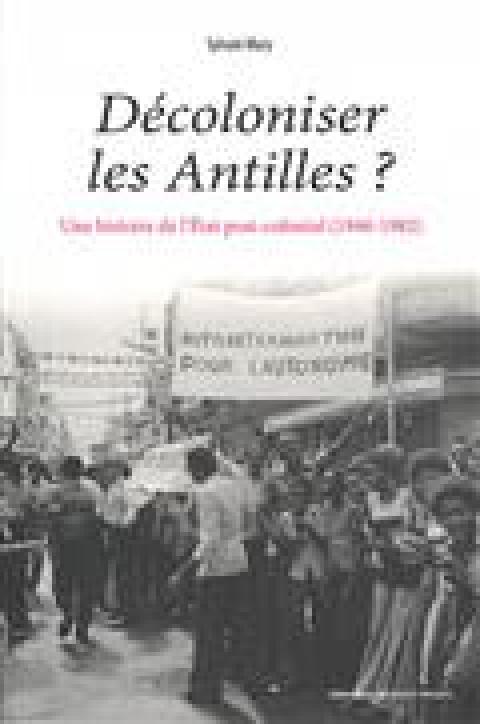
Professeur agrégé d’histoire (PRAG) à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, docteur en histoire contemporaine, Sylvain Mary est chercheur associé à l’UMR 8138 Sirice (Université Panthéon-Sorbonne/Sorbonne Université/CNRS. De sa thèse de doctorat, il a tiré un ouvrage appuyé sur un large dépouillement d’archives (Archives nationales, Archives nationales d’outre-mer, Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve et Nantes, Service historique de la Défense, Centre des Archives économiques et financières, Archives départementales de la Meuse, de Seine-Saint-Denis, de la Guadeloupe et de la Martinique, Archives nationales des États-Unis et du Royaume-Uni, Archives de la Fondation nationale des sciences politiques, de la Fondation Charles de Gaulle et de l’Institut mémoires de l’édition contemporaine). Servi par un appareil critique très complet, le livre a mobilisé d’abondantes sources imprimées, une bonne dizaine d’interviews (dont celles de Michel Levallois et d’Olivier Stirn) et une opportune bibliographie sélective.
Dans l’introduction de son livre, Sylvain Mary montre comment la départementalisation introduite en mars 1946 a conduit à la formation d’un antagonisme entre défenseurs du département et partisans de l’autonomie ou de l’indépendance. Il fait apparaître aussi trois grandes époques, qui se sont succédées sans que, pour autant, il y ait eu rupture dans l’action de l’État, conçue comme « une entité composée d’acteurs appartenant à des institutions interdépendantes ». Ces trois séquences - ou parties - sont les suivantes : de 1946 à 1959, la départementalisation est conçue comme un levier de la réforme impériale et un bouclier contre l’anticolonialisme international (chapitre 1). Il s’ensuit la mise en place d’une nouvelle administration (chapitre 2), mais aussi l’apparition d’un mécontentement croissant, contraignant à des ajustements techniques apportés au dispositif de cette politique (chapitre 3).
Toutefois, cet échec de la transition étatique débouche sur un regain de volontarisme étatique, dans les années 1960, sous l’égide et l’impulsion du général de Gaulle (deuxième partie). La République gaullienne fait face à une décennie de contestation de la départementalisation. Cet ordre concerne le domaine politique (chapitre 4), dans celui économique et social (chapitre 5) avec pour but d’assurer le statu quo international, ce qui suppose la prise en compte de la dimension internationale, en particulier de la révolution cubaine (chapitre 6). La troisième partie couvre la période allant du milieu de la présidence pompidolienne au début du premier septennat de François Mitterrand. Le tournant date en effet de 1971 (chapitre 7) et se trouve amplifié par le projet de « société libérale avancée » de Valéry Giscard d’Estaing (chapitre 8). Durant son septennat, émerge un espace inédit de liberté politique propice à l’expression des idées anti-départementalistes. Le socialisme propose un renouvellement, parce qu’en faveur de l’autodétermination des peuples d’outre-mer, la départementalisation ne constituant pas aux yeux des socialistes un vecteur de décolonisation efficace.
En définitive et en premier lieu, de la colonie au département, les Antilles ont connu un processus empirique. De fait, en 1981, la France exerce toujours sa souveraineté dans un cadre statutaire inchangé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ni la Guadeloupe, ni la Martinique ne sont de simples caricatures de départements. Si les pratiques attentatoires aux normes démocratiques se sont réduites, la hausse du niveau de vie s’est faite au prix d’un développement artificiel et de la dépendance économique, tandis que des inégalités héritées de l’ère coloniale et esclavagiste n’ont pas disparu. L’on peut donc parler d’une « décolonisation par intégration » (Jean-Claude William).
En second lieu, celle-ci obéit à une chronologie précise :
1/ au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une départementalisation précipitée, sous-estimant le désenchantement conjoint des élites politiques et des masses ;
2/ avec le retour au pouvoir du général de Gaulle, la décision est prise de sauver le statut départemental pour des raisons de sécurité, de stabilité économique et sociale, d’endiguement du communisme et pour empêcher la formation de mouvements de libération nationale. Enjeu des relations franco-américaines, la Guadeloupe et la Martinique font l’objet, à partir du référendum constitutionnel de septembre 1958 et, surtout, des rébellions urbaines de décembre 1959, d’une prise en main vigoureuse de l’appareil d’État. Aucune inflexion n’est sensible après les rébellions urbaines de mai 1967.
3/ Si l’élection à la présidence de Valéry Giscard d’Estaing marque un changement, ce dernier survient pour l’essentiel avec les socialistes : les idées autonomistes ne sont plus perçues comme subversives, antinationales et séparatistes, alors que, dans le domaine de la culture, les pouvoirs publics affichent une volonté inédite de promotion et de défense des identités dans le cadre de la nation française.
En troisième lieu, le changement est diffus. En effet, la décentralisation remet en cause les équilibres traditionnels du pouvoir local : la droite départementaliste s’accommode des réformes statutaires portées par la gauche, évolution du RPR d’un interventionnisme étatique à un libéralisme économique assumé, rattrapage social engagé sous l’impulsion du pouvoir socialiste. Désormais, la priorité va à la lutte contre le sous-développement, en conciliant décentralisation et promesse d’égalité. L’évolution des indépendantistes permet même au Mouvement indépendant martiniquais de conquérir la région en 1998. Une conscience nationale semble donc bien s’exprimer à travers le sentiment d’appartenir à un peuple partageant la même culture et la même histoire. Elle reste cependant minoritaire, la majorité de la population s’en tenant d’abord à la revendication de l’égalité.
En quatrième et dernier lieu, la dynamique du changement finit par produire des effets spectaculaire tant dans la classe politique antillaise que du côté de l’État : relance, en 1999, du débat sur l’organisation décentralisée de la République, le statut départemental apparaissant comme un obstacle au développement économique ; en décembre 1999, déclaration de Basse-Terre entre l’indépendantiste Alfred Marie-Jeanne et la gaulliste Lucette Michaux-Chevry, présidente du conseil régional, demandant le passage du statut de département à celui de collectivité territoriale. L’évolution contraste avec celle de la Réunion, où le statut départemental n’est pas remis en cause. A cet égard, la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 s’avère importante, qui ouvre la possibilité aux DOM et aux ROM de se doter d’une collectivité territoriale unique exerçant les compétences départementales et régionales. Après les déclarations d’Yves Jégo, secrétaire d’État à l’outre-mer, « prêt à travailler sur tous les sujets, même tabous », en 2009, puis le rapport Balladur de 2010, une nouvelle consultation des territoires et régions d’outre-mer. Tandis que la Guadeloupe se contente du droit commun de la nouvelle réforme, un référendum aboutit, à la Martinique, à la création d’une collectivité unique, cumulant les compétences des conseils généraux et régionaux, mais n’équivalent pas encore à l’autonomie. On aura compris tout l’intérêt de cet ouvrage, même s’il n’échappe pas totalement au choix d’un biais plutôt favorable aux socialistes.