


| Auteur | Didier Ortolland |
| Editeur | l’Harmattan |
| Date | 2025 |
| Pages | 274 |
| Sujets | Politique maritime Chine 1970-.... Relations internationales Chine, Mer de 1970-.... Droit de la mer Chine 1970-.... |
| Cote | 69.471 |
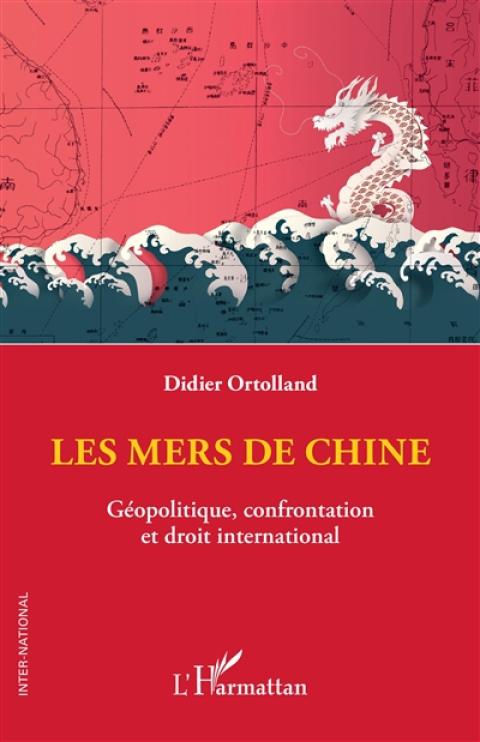
En incluant les îles, la façade maritime de la Chine représente 14 500 km. Au cours des siècles, les populations côtières ont toujours entretenu un lien étroit avec la mer, comme pêcheurs ou navigateurs. La dynastie Song ((960-1279) encouragea le commerce maritime en mer de Chine méridionale et en Asie du Sud-Est mais il restait souvent entre les mains d’armateurs étrangers. Sous la dynastie Ming, Zeng He mena entre 1405 et 1433, sur ordre de l’empereur, des expéditions qui conduisirent ses navires jusqu’à l’océan Indien et à la mer Rouge, mais elles furent sans lendemains. La Chine n’a pas engendré d’aventuriers visionnaires comme Colomb, Vasco de Gama ou Magellan. Elle n’a jamais non plus patronné d’expéditions scientifiques comme celles de Cook, Bougainville ou La Pérouse. Les puissances extérieures, à commencer par le Japon, ont profité du déclin de l’Empire au XIXème siècle et d’une marine chinoise embryonnaire : en 1937, à la veille de la guerre sino-japonaise, la marine de guerre chinoise est très faible. En 1945, la Chine n’a plus de flotte de commerce.
Aujourd’hui, la Chine est la première puissance maritime mondiale. Les importations chinoises par la mer représentent un quart du trafic maritime mondial. Sur les dix premiers ports à conteneurs de la planète, sept sont chinois. Cosco est le premier opérateur de terminaux portuaires. 40% de la construction navale se fait en Chine. La flotte chinoise est la première du monde. La Chine construit tous les quatre ans l’équivalent de la flotte de notre Marine nationale. Sur le plan stratégique, cette ascension exceptionnelle s’explique par trois contraintes fortes. La géographie côtière fait que la Chine ne peut pas projeter sa puissance en toute sécurité : en mer de Chine orientale, le Japon, Taïwan, les Philippines, constituent une chaîne d’îles entre la côte chinoise et le Pacifique occidental. La mer de Chine méridionale est stratégique pour ses approvisionnements en hydrocarbures et en matières premières et la pérennité de la croissance chinoise passe en grande partie par la liberté de passage dans le détroit de Malacca. Enfin, la Chine voit dans le droit de la mer un obstacle à sa volonté d’expansion maritime, et refuse d’en appliquer des dispositions substantielles.
Ancien diplomate, Didier Ortolland a été sous-directeur du droit de la mer et des pôles à la direction des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et il a dirigé à ce titre la délégation française dans plusieurs enceintes et négociations régionales et internationales. Il est l’un des meilleurs spécialistes français du droit de la mer. Il consacre un livre très intéressant à cette zone de tensions et de conflits, ouverts ou potentiels, que représentent la mer de Chine orientale et la mer de Chine méridionale que les autorités chinoises considèrent comme leurs espaces maritimes et aux ambitions chinoises qui vont au-delà : Indopacifique, Antarctique, grands fonds marins.
La mer de Chine orientale est commune à la Chine, à Taïwan, au Japon et à la Corée. Les deux principales puissances asiatiques se font face sur près de 2 000 km. C’est un espace stratégique pour les États industrialisés de la région dont la prospérité repose largement sur le commerce et la navigation. Il est le théâtre de plusieurs contentieux, anciens et très politiques : statut de Taïwan dont l’indépendance de fait n’est pas acceptée par la RPC et la prive d’un accès direct au Pacifique occidental ; revendications croisées de la Chine et du Japon sur les îles Senkaku/Diaoyu ; question des détroits japonais. Le détroit de Taïwan est stratégique pour les importations chinoises. Taïwan, avec TSMC, assure 52% de la production mondiale de circuits intégrés et la dernière génération des puces électroniques est indispensable au développement de l’IA du monde entier. Les intentions de la Chine sont ambigües. En 1972, Mao Zedong avait assuré Richard Nixon que la Chine n’emploierait pas la force pour récupérer Taïwan : « Nous pouvons nous passer d’eux pour le moment, nous verrons dans cent ans ». Xi Jinping a déclaré : « La RPC veut achever la réunification par des moyens pacifiques » mais il a dit également : « La réunification totale de la patrie est une tâche historique qui doit être menée à bien et sera menée à bien. » Les manœuvres d’intimidation de la marine et de l’armée de l’air chinoises sont fréquentes et Taïwan a déjà été victime d’un blocus numérique par sabotage des câbles sous-marins.
Le contentieux sino-japonais sur les cinq petites îles inhabitées de Senkaku/Diaoyu remonte au XIXème siècle : cédées par la Chine au Japon en 1895 par le traité de Shimonoseki, placées sous le contrôle des États-Unis en 1945 en même temps qu’Okinawa, elles ont été restituées au Japon en 1971. Le contentieux a pris ces dernières années un tour aigu, avec une délimitation unilatérale chinoise de ses espaces maritimes qui inclut les cinq îles et une extension de ses prétentions à l’espace aérien. Le différend sino-japonais concerne directement Washington. Les présidents Obama, Trump et Biden ont assuré tour à tour qu’en application du traité américano-japonais de 1960, les États-Unis défendraient le Japon si la Chine attaquait Senkaku/Diaoyu.
Une autre source de tensions vient de ce que les côtes chinoises ne font jamais face à la haute mer car il y a toujours d’autres États au large qui interdisent un accès direct au Pacifique Ouest. La marine nationale chinoise multiplie, en toute légalité, des exercices d’intimidation dans les détroits qu’elle est obligée d’emprunter : détroit de Miyako entre la Chine et le Japon, détroit de Luçon et canal de Ballingtang entre Taïwan et les Philippines.
Plus au Nord, la mer Jaune, entre la Chine et les deux Corées, donne lieu à un contentieux sur le mode de délimitation des plateaux continentaux, créant une insécurité juridique qui entrave les projets d’exploration d’hydrocarbures.
En mer de Chine méridionale, avec d’autres États voisins (Philippines, Thaïlande, Malaisie, Indonésie), tensions et conflits sont d’une nature différente mais procèdent toujours de la même volonté d’affirmation de souveraineté de la Chine. Elle a délimité sa zone économique exclusive à sa façon, s’affranchissant des règles fixées par la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, à l’élaboration de laquelle elle a pourtant participé, et qui n’a donc rien d’un « traité inégal ». Didier Ortolland compare la mer de Chine méridionale à une « Méditerranée asiatique » par où transitent près de la moitié des matières premières importées par la Chine et, pour le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, la totalité des hydrocarbures. C’est un espace constellé d’îlots, de rochers, de hauts fonds affleurant à marée basse. Le livre rappelle les revendications françaises sur les Paracels et les Spratley, au temps de l’Indochine, au nom de l’Annam et de la Cochinchine. Proche des côtes vietnamiennes, occupé par l’armée chinoise depuis 1955, l’archipel des Paracels est revendiqué par le Vietnam et la Chine. A proximité des côtes des Philippines et de la Malaisie insulaire, l’archipel des Spratley est revendiqué en totalité par la Chine qui construit des pistes pour son aviation sur des îlots inhabités qu’elle « poldérise », et par le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et Brunei.
En vertu de son principe de calcul dit de la « ligne des neuf points », la Chine a attribué unilatéralement, même à de petits rochers, une zone d’exploitation économique beaucoup plus large que les 12 milles de mer territoriale que le droit de la mer leur reconnaît, et qui empiète sur les ZEE des pays voisins. Cette politique entrave leurs projets d’exploitation pétrolière et gazière. Les dix États membres de l’ASEAN (700 millions d’habitants, dont 25 d’origine chinoise), ont créé avec la Chine, leur premier partenaire commercial, le Forum de concertation ASEAN + 1 qui a adopté un code de conduite en mer de Chine méridionale, au terme duquel les parties s’engagent à faire preuve de retenue dans leurs activités navales et à ne pas installer de population sur des structures marines inhabitées. Au nom de ce qu’elle considère comme des « droits historiques », la Chine ne respecte pas le code.
Pékin refuse également, par principe, toute cogestion des espaces maritimes pour la recherche pétrolière et pour la protection des ressources halieutiques alors que la pêche nourrit en Chine et en Asie du Sud-Est des centaines de millions de personnes. Les Philippines, la Malaisie et la Thaïlande ont conclu de tels accords entre elles qui fonctionnent bien. La Chine importe les deux-tiers de sa consommation d’hydrocarbures dont 70 % transitent par le détroit de Malacca et la mer de Chine méridionale. Les réserves évaluées d’hydrocarbures de la mer de Chine méridionale sont du même ordre que celles de l’Algérie. Un blocage de la navigation en mer de Chine méridionale affecterait fortement l’économie du Vietnam, de la Thaïlande ou de Singapour.
La Chine a refusé d’aller à l’arbitrage pour régler son contentieux avec les Philippines dont l’enjeu était la surpêche chinoise et les libertés prises par la Chine avec le droit de la mer. En 2016, elle a refusé d’appliquer la sentence du tribunal arbitral qui donnait raison aux Philippines. Fondamentalement, elle ne peut concevoir de relations entre égaux. Elle veut restaurer sa puissance passée et instaurer une sphère sous influence chinoise en Asie du Sud-Est mais aussi dans le Pacifique, première zone de pêche du monde (58% des captures mondiales). Elle se livre, avec des moyens massifs et en toute impunité faute d’organisation régionale pour la contrôler, à une surpêche qui viole les droits des États côtiers et les conventions de protection des espèces. La Chine est de plus en plus présente, par ses investissements, dans les États insulaires du Pacifique Sud, pour contrer les ambitions de Taïwan et contrôler les routes maritimes. Elle est en confrontation directe avec l’Australie et ses alliés américains et britanniques de l’AUKUS. Elle s’intéresse de plus en plus à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
Didier Ortolland étudie la politique chinoise de présence dans l’océan Indien, destinée à assurer la sécurité de ses approvisionnements, des détroits de Bab-el-Mandeb et Ormuz (celle de Djibouti est la plus importante base chinoise outre-mer) au détroit de Malacca, à travers les politiques du « collier de perles », de la « route maritime de la soie », des corridors stratégiques du Pakistan et de Birmanie et la rivalité avec l’Inde, dimension structurante de sa politique étrangère. Avec cinq bases à vocation militaire autant que de recherche, la RPC est présente en Antarctique dont les abondantes ressources halieutiques (krill) et les ressources minières encore non exploitées l’intéressent. Dans la course mondiale aux matières premières, et en particulier aux minerais critiques nécessaires à la transition énergétique et numérique, les grands fonds marins sont devenus une cible pour la politique chinoise qui exploite leurs richesses, cette fois-ci en conformité avec le droit international, dans le cadre des contrats que délivre à ses opérateurs l’Autorité internationale des fonds marins.
Accompagné de cartes, d’une chronologie des principaux événements intervenus dans les deux mers de Chine depuis six siècles et d’une bibliographie, l’ouvrage de Didier Ortolland est très intéressant à plusieurs titres. Il analyse, en croisant approches juridique, politique, économique, historique et prospective, la politique maritime de la République populaire de Chine, pilier essentiel de sa volonté de puissance.
Il expose, de façon à la fois fouillée et claire, un cas éclairant de remise en cause de l’ordre international par le Sud global, avec celle du droit de la mer par la Chine. Il nous donne les clés pour comprendre les fondamentaux d’un arc de crise majeur.