


| Auteur | Gilles Guiheux et Lu Shi |
| Editeur | Les belles lettres |
| Date | 2025 |
| Pages | 345 |
| Sujets | Chinois (langue) Néologismes Chinois (langue) Langage politique Langues Aspect politique |
| Cote |
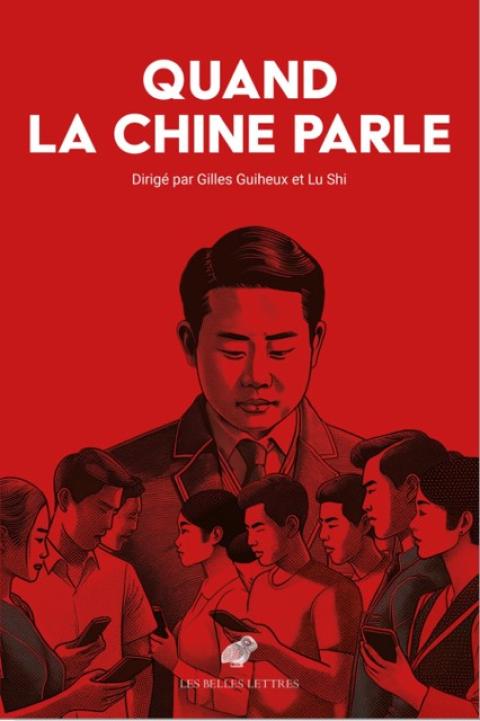
La Chine, face à l’Occident, se pose avant tout comme « mystère », à commencer par sa langue au support écrit impénétrable. Voilà un monde qui évolue, vibre, respire à nos côtés, sans que pour la plupart, nous puissions capter son souffle, ni sa vie, faute de les entendre. Pourtant à fréquenter ce peuple, on le découvre en cent points semblable au nôtre, partageant nos espoirs et nos rêves, nos colères, nos passions et nos vices avec une logique immuable, celle de l’humain.
Deux sinologues, Gilles Guiheux et Lu Shi ont entrepris la tâche monumentale de présenter l’Empire du Milieu à travers le prisme d’expressions chinoises issues des 20 dernières années. En filigrane de ces créations spontanées, on peut y lire l’évolution des mœurs, les réalités nouvelles, résultats des choix politiques et de la prodigieuse mutation de cette Chine qui s’éveille, après le coup de fouet de la révolution maoïste et les 30 glorieuses économiques imprimées par Deng Xiaoping. Tout un vocabulaire s’est ainsi formé, issu du débat foisonnant sur la toile chinoise où pratiquement toute la population se retrouve et échange. Toutefois si l’internet chinois est le pétrin, la parole du peuple la pâte à pain, la censure elle, en est le levain. Dès sa naissance, vers les années 1990, ce forum de l’opinion en ligne est resté sous le contrôle étroit du régime qui n’hésite pas à en interdire les tendances qui lui déplaisent. Appliquées en continu sur les moteurs de recherche et dans les portails d’échange, ses interdictions orientent le débat. En face, la masse des internautes joue avec cette censure pour contourner sa « grande muraille de feu » et faire passer ses messages, moyennant toutes sortes de techniques imaginatives. Le résultat étant, bien souvent, ces expressions savoureuses qui forment l’âme et la conscience de la Chine moderne. « Quand la Chine parle », œuvre collective de Guilheux, Lu Shi et 14 jeunes chercheurs, rassemble 34 de ces néologismes et décrypte autant d’évolutions et de manières de vivre des temps chinois présents.
Wanghong, 网红« Les rouges de l’internet », désigne les stars, les influenceurs ou influenceuses de l’opinion. En 2016, la vidéaste Papi Jiang a été la 1ère Chinoise à ratisser 12 millions de yuans (près de 2 millions d’euros en ligne) en racontant en live sa vie quotidienne, par petites anecdotes divertissantes qu’elle truffait d’annonces publicitaires. Le « rouge » en question évoque dans les esprits la réussite de ces jeunes, symboliquement comparée à celle de la Chine nouvelle socialiste. Rien qui ne puisse déplaire aux censeurs officiels. Mais bientôt, prenant de l’assurance, ces annonceurs peuvent se risquer à égratigner le régime. C’est ainsi qu’en 2022 Li Jiaqi, le très populaire « roi du rouge à lèvres », a vu son compte suspendu pour trois mois, après avoir osé montrer un gâteau en forme de char d’assaut dans son épisode du 3 juin, à la veille d’anniversaire du massacre de Tiananmen : c’était une date anathème de celles que le régime s’efforce par tous les moyens d’effacer des mémoires !
Peisong xiaoge, 配送小哥 évoque « Les petits grands frères de la livraison » : les coursiers du net, ceux qui hantent l’asphalte à longueur de journées pour livrer les repas ou petits colis commandés sur Taobao. En 2020, ils sont 84 millions, tous en scooters électriques ou fourgonnettes et « pèsent » 10% de la population active. Une grosse partie d’entre eux roulent sous la bannière de trois groupes nationaux comme Ele.me ou Meituan. Depuis son bureau, telle mère peut commander à la fois ses emplettes familiales (lessive, fruits et légumes, sous-vêtements) ou plateau repas. Le tout est payé en quelques clics sur son smartphone via les applications WeChat ou Alipay, puis livré, parfois en moins d’une demi-heure. Souvent issus de la campagne, ces livreurs ont 31 ans en moyenne. Ils travaillent dur - 10h par jour ou plus, payés à la commission (famélique) - bien rares ceux qui dépassent aujourd’hui 4000 yuans par mois (250€), ce dont nul ne peut vivre. Certains se suicident. D’autres, ayant osé protester, sont arrêtés pour désordre public. Ils sont le nouveau prolétariat de l’Empire du Milieu, invisibles, exploités et sans droits.
Tanping, 躺平, « Rester couché » est un des mots les plus récents et les plus forts. Il qualifie chez les jeunes adultes de la bourgeoisie moyenne, la résistance passive contre un ordre social qui les désespère. En creux, il dénonce la contradiction entre un système qui parvient à former 7 millions de diplômés par an, sans leur offrir un emploi à la hauteur de leur compétence et de leurs espoirs. Ainsi, 20% des coursiers décrits au point précédent sont passés par l’université. Se voyant offrir un emploi sous-qualifié et à bas salaire en « 9-9-6 », formule signifiant un horaire de 9h du matin à 9h du soir, six jours par semaine, ils préfèrent rester chez papa-maman, ou bien vivre sans consommer, pauvres mais dignes. Les prix qui s’envolent n’arrangent rien, ceux du logement surtout, inabordables. Pour les garçons, avoir un appartement est obligatoire pour pouvoir passer par la case « mariage ». Mais de toute manière, on ne veut plus non plus se marier, ni faire d’enfants. Le slogan du Tangping n’est pas pour peu dans la montée inquiétante du chômage des jeunes, 18% officiellement en 2025 - mais en réalité, probablement le double.
Fanxiang qingnian, 返乡青年, nous parle « Des jeunes qui retournent à la campagne », une mode qui gagne chaque année. Rien qu’en province de Canton en 2019, les « Jeunesses communistes » s’apprêtaient à voir de 100.000 jeunes repartir au village natal chaque année. Ce lot social regroupe tous types de profils, à commencer par les chômeurs qui trouvent refuge chez les parents ou grands- parents ruraux. Il y a aussi le couple de jeunes professionnels qui opte, après quelques années vécues entre pollution, stress, béton et bitume, pour refaire leur vie dans un projet agro-écologique. En ce cas d’espèce, le régime et ces jeunes ont des visions aux antipodes. Pour ces derniers, le retour au calme des campagnes va nourrir la promesse d’échapper au matraquage idéologique, publicitaire ou consumériste des villes, voire de vivre une renaissance spirituelle (bouddhiste, chrétienne). Un atelier de réflexion, la création d’écoles non violentes sont souvent au cœur du projet : ces jeunes veulent changer la vie et pas que la leur. De son côté cependant, l’État en recyclant ces jeunes à la campagne, espère débarrasser la ville de contestataires trop bouillants et refusant le modèle et de jeunes pauvres qu’il aurait dû assister. Idéologiquement aussi, ce retour à la campagne ressemble comme deux gouttes d’eau au grand « retour à la campagne » orchestré par Mao à la révolution culturelle qui avait occasionné le départ de 14 millions de « jeunes instruits » vers les communes populaires, exploités comme manœuvres agricoles. C’est ainsi que parti des jeunes, ce mouvement est récupéré par le régime, pour qui c’est tout bénéfice : il lui permet, selon les auteurs, de « réinscrire les politiques contemporaines dans l’histoire communiste de la révolution paysanne » !
Sicai yitang四菜一汤, «Quatre plats et une soupe » : Depuis les années ’50, inlassablement et vainement, cette directive appelle les cadres du Parti à limiter les banquets à quatre plats et une soupe, dîner frugal. En 2012, Xi Jinping a dénoncé la goinfrerie comme « hédonisme », au côté des trois autres vices du formalisme, de la bureaucratie et de l’extravagance. Mais la directive a du mal à être acceptée. C’est que tout au long des années 50, les révolutionnaires eurent à se repaître de slogans plus souvent que de vrais repas rassasiant leur faim. Quand l’occasion se présentait d’un festin aux frais du socialisme, on n’allait pas s’en priver au nom de la morale !
Sous Deng Xiaoping, quand les choses commencèrent à aller mieux, le haut cadre important invita. Le dîner lui permettait d’afficher son pouvoir, de renforcer sa popularité, de rendre des services rendus, et tout simplement de corrompre. Voilà pourquoi la Chine a toujours conservé et chéri l’art subtil de concilier idéologie et intérêt individuel et de tordre les consignes pour les adapter à ses besoins matériels. En matière de banquets, dès les années 1990, les services publics ont commencé à utiliser des assiettes ou bols individuels surdimensionnés et cloisonnés en croix : dans ces récipients, les convives avaient droit à 16 plats et quatre soupes… tout en restant en règle !
Mitu 米兔, « Riz-Lapin » : ces caractères sont la transcription phonétique du slogan féministe MeToo qui déferla sur le monde à partir de 2018. En Chine certes, le PCC ne saurait tolérer une campagne issue du monde blanc anglo-saxon. Mais déterminée à prendre en marche le train de la revalorisation des droits féminins, les jeunes Chinoises ont rendu la tendance moins nocive, en la présentant sous ces caractères « riz et lapin », moins offensifs et plus enfantins. Tout commença par la plainte d’une étudiante entretemps émigrée aux USA qui dénonçait le harcèlement par un cadre de son université. Vigoureusement soutenue, la dénonciation en inspira de multiples autres. Une fois la vague lancée, un puissant mouvement se constitua pour réclamer à corps et à cris protection contre le harcèlement et les violences domestiques, pour la reconnaissance des droits LGBT ou la liberté d’habillement. Dans les grandes villes, les happenings de Femen montrant leurs corps dénudés et tagués de slogans féministes se multiplièrent … A partir de 2012, Xi Jinping mit toutefois fin à cette agitation : une campagne d’arrestations, de pressions et d’interdictions stoppa net l’expression du féminisme. Il est pourtant bien éveillé, en veilleuse, et attend son jour.
Xiaoxianrou 小鲜肉, «Petite viande fraiche » : les femmes d’un certain standing appellent ainsi les jeunes éphèbes habillés modernes et bien mis. L’article cite comme archétype Li Yifeng, le chanteur et acteur star de la TV et de l’internet. C’est récent et révolutionnaire en ce monde tenu jusqu’alors de main de fer par les hommes. « Xiaoxianrou, dit l’auteur, renverse l’hégémonie du regard masculin en mettant au 1er plan le désir féminin ». Elle fait de l’homme un objet de consommation - un être qui peut être entretenu et acheté par une « cougar » (selon le terme français). Le « xiaoxianrou » pourrait être l’équivalent du gigolo franco-américain, à une nuance près qu’à peine sorti de l’adolescence, il est supposé être « inexpérimenté », innocent. L’expression traduit la hausse du pouvoir d’achat de certaines femmes enrichies et sures d’elles-mêmes. Elle impose au passage « denouvelles représentations de la masculinité dans l’espace public ».
Xinghun 形婚, « Mariage coopératif ». On entre ici dans l’alcôve secrète de l’homosexualité chinoise. Sous Deng Xiaoping, 30 ans d’adoucissement des mœurs avaient réhabilité cette pratique et laissé s’introduire une certaine tolérance envers elle, dans les milieux de la littérature, du cinéma ou de la danse. Les LGBT avaient leurs bars. A condition de maintenir une discrétion maximale et surtout de ne pas afficher une vie conjugale au grand public. Toutefois la tendance semble s’être inversée à partir de 2010. Au recensement décennal de cette année-là, à 35 ans, 92% des hommes et 97% des femmes se sont déclarés mariés au moins une fois. Plus que jamais, les personnes LGBT revendiquant leur identité homosexuelle doivent passer par un mariage hétéro. Mais à cette union de convenance qui contrarie leurs convictions, ils ont trouvé l’alternative : le mariage coopératif, où une lesbienne épouse un gay. Ils peuvent convenir de procréer ensemble, mais la finalité de leur union est ailleurs : celle de les mettre en règle, tout en préservant à chacun sa liberté sexuelle. Plusieurs sites internet permettent de préparer ces unions. En 2023, l’un d’eux comptait près de 470.000 membres, et 56.000 couples « mariés coopératifs ». Curieusement, en dépit de sa rigidité accrue, l’État semble ne pas trop s’ingérer. En raison peut-être de son intérêt bien compris : traquer le mariage « Xinghun », risquerait de replonger l’homosexualité en clandestinité, au risque de voir redémarrer le sida, faute de coopération entre services de santé, police et homosexuels, le 1er groupe à risque…
Shengnü et Shengnan 剩女, 剩男 « Hommes et femmes laissés pour compte », autrement dit les femmes non mariées après 27 ans et les hommes après 30 ans, de ce fait victimes d’un mépris social. Pour les hommes, cette solitude est souvent imposée par le choix de leurs parents 20 ans plus tôt, d’éliminer les embryons féminins afin de conserver la chance d’avoir un héritier mâle, en ce pays resté jusqu’aux années 2010 sous la politique d’un enfant unique par couple. Mais cela a donné à terme un déficit de 32 millions de filles à marier, et arithmétiquement autant de garçons privés de mariages. On les appelle en Chine 光棍 (guanggun), ou branches mortes.
Chez les filles, c’est une autre affaire : une minorité refuse de se marier, afin d’éviter la dépendance envers un mari machiste. A l’heure où la Chine est dépassée par l’Inde comme n°1 mondial en population, et où le taux de nuptialité est tombé de 9,9/1000 en 2013 à 4,3/1000 en 2024, cet absentéisme des jeunes femmes dans les maternités est vécu comme une trahison. Aussi la société se mobilise pour stigmatiser les transgresseuses au devoir de reproduction. Les parents font pression, revendiquant un héritier. L’État encourage les mariages : certains parcs sont aménagés en foires aux mariages où les parents affichent les données de leur enfant, espérant trouver chaussure à leur pied. Mais les demoiselles prennent leur destin en main : dès 2016, elles créent leur association contre le mariage forcé. Bilan, selon l’auteur : la chute du mariage traduit la montée de l’individualisation des femmes et de leur aspiration à choisir par elles-mêmes. Elle traduit aussi une opposition de phase entre la volonté des femmes et celle de l’État.
Zhongguo dama 中国大妈 « Les grandes dames chinoises » : ces femmes proches du 3ème âge se distinguent des autres. Par leur habillement d’abord - très coloré, et soigné. Souvent déjà à la retraite, elles se rassemblent pour combattre leur désœuvrement et leur perte de statut social. Elles apparaissent aussi sans gêne, n’hésitant pas à danser ensemble en public, chamarrées et sûres d’elles, ayant vaincu leur peur. La raison de cette liberté nouvelle est attribuée aux habitudes acquises durant la révolution culturelle, à une insensibilité vis-à-vis du qu’en dira-t-on. Mais une autre raison pourrait bien être le sentiment d’avoir servi leur société, payé leurs dettes et d’avoir conquis le droit à agir comme bon leur semble - sentiment fort contraire à la morale et aux traditions. Une fois âgées, plus rien ne semble pouvoir les décourager de revendiquer leur liberté chèrement gagnée, le droit d’exister dans l’espace social.
Diduan renkou 低端人口 « Populations bas de gamme » : chaque année à époque régulière - avant la fête du printemps ou la fête nationale, la police fait du nettoyage social, porte à porte, pour exfiltrer les personnes sans permis de résidence, voire d’autres personnes déplaisant au régime, tels certains dissidents. Tous sont renvoyés à leur village, au moins hors de la grande ville, avec possibilité de retourner après les fêtes : ce sont les populations « bas de gamme ». Plus récemment, les mégapoles comme Shanghai (23 millions) ou Pékin (21 millions) entendent mettre à l’écart pour de bon ce type d’habitants, au nom de l’amélioration de la qualité de leurs résidents. Des campagnes sont lancées, pour « enquêter, nettoyer et rectifier l’habitat au nom de la sécurité des personnes. »
Le problème est que ces gens à petits salaires, travaillant dur sans se plaindre, sont écartés de leurs collègues, familles et amis, ce qui est injuste et contraire à l’objectif recherché de stabilité sociale. Par de telles campagnes, le régime crée une double contradiction. Idéologique d’abord - après avoir prétendu éliminer la lutte des classes chères à Marx, il la recrée et accentue le ressentiment entre riches et pauvres. Contradiction économique ensuite - ces classes à faible revenu s’avère en fait indispensables à la bonne marche de la ville, de ses PME, et leur départ met à risque le bien-être général.
Pour les identifier d’ailleurs, l’État use de procédés qui rappelle une autre de ses politiques contestables, celle du crédit social : le classement en population « haut » et « bas » de gamme se fait sur base de technologies de surveillance et d’analyse des big data, distribuant récompenses et pénalité. De la sorte, le pays est tenté de fixer les « bons » citoyens au centre des métropoles, et les « mauvais » en périphérie. Sans connaître à ce stade, les conséquences à long terme !
Pengci 碰瓷, « Casser la porcelaine ». C’est une fraude ultraconnue en Chine, celle où un humain se jette sous une voiture, en prenant soin d’éviter de passer sous les roues. Quand le propriétaire sort du véhicule, la fausse victime simule des souffrances, prétend que l’autre l’a fauché et revendique des réparations financières. L’origine de cette fraude est plus ancienne, datant de la fin du XIX siècle : des vendeurs déposaient des porcelaines de faible qualité au bord de la route, gênant le trafic pour amener les chauffeurs à briser la poterie, suite à quoi le vendeur réclamait une lourde compensation.
Variante : un blessé au bord de la route est conduit à l’hôpital par un chauffeur compatissant, suite à quoi le sauvé porte plainte, accusant son sauveur de l’avoir écrasé. Le juge ayant de bonne chance de considérer que l’acte de bienveillance du chauffeur, serait en soi un aveu de culpabilité.
Ce type de fraude a eu en Chine un effet dévastateur, incitant la population entière, en cas d’accident dont elle est témoin, à fermer les yeux et passer son chemin. Plus récemment, plusieurs recours sont apparus. Une loi du « bon samaritain » a été votée en 2017 qui dédouane tout sauveteur de responsabilité sur les conséquences de son acte. Un autre moyen consiste à filmer de son smartphone la scène avant le sauvetage. De même, de nombreux véhicules sont aujourd’hui équipés de caméras permettant de protéger les chauffeurs contre les escrocs candidats aux faux accidents. Ce type d’arnaque s’achemine sans doute vers sa disparition. Mais en soi, la pratique souligne le problème social du manque d’empathie en Chine qui peut être vu comme un des résultats négatifs de l’instauration d’une société socialiste autoritaire.
Peidu mama 陪读妈妈 « Mères accompagnatrices d’études » : Il s’agit d’un phénomène en pleine expansion en Chine où les études de l’enfant unique, source unique d’ascension sociale, sont considérées comme la priorité absolue dans les foyers. Parfois, la filière choisie passe par un départ au loin, dans une autre province ou à l’étranger. Mais plus le jeune s’éloigne de son milieu naturel et plus il risque de perdre pied, confronté à un programme ardu et à de multiples tentations. Statistiquement, un certain nombre de ces enfants « expatriés » échouent ! Aussi, pour palier le danger et sécuriser leur investissement, de plus en plus de parents choisissent d’envoyer la mère auprès de l’héritier afin de lui prêter assistance le temps de ces études.
Ce scénario compte plusieurs variantes. Dans la première, la disparition rapide des écoles de campagne (de 440.000 à 155.000 en 12 ans jusqu’en 2012) force des centaines de milliers d’enfants par an à quitter le village pour la petite ville voisine, en internat ou chez l’habitant. Mais une fois sur place, livré à lui-même, il risque de se perdre dans le jeu sur son smartphone ou en internet café. Aussi, la mère l’accompagne prend un appartement, lui fait la cuisine, le lit, les révisions des cours si elle en a le niveau. Elle peut même réussir à trouver un emploi local. Cette vie nouvelle, à deux, va aussi lui permettre de tenter de renouer avec ce fils que souvent elle ne connait guère : tenter un dialogue, apprendre à se comprendre - mais ce n’est pas gagné.
Une autre variante, évidemment réservée aux plus riches, est le départ vers le Canada, l’Australie, les USA ou l’Europe, pour un diplôme international prisé sur le marché chinois du travail. Souvent, on vise aussi pour l’enfant l’obtention d’une nationalité du pays d’accueil -l’abandon d’un pays jugé trop sclérosant. Mais ici, les problèmes d’aliénation sur un sol inconnu sont aggravés par la méconnaissance de la langue locale (l’anglais le plus souvent), d’autant plus grave que les jeunes Chinois expatriés ont tendance à rester ensemble. Là aussi, bien des mères décident de suivre leur enfant dans son expatriation. En 2022, elles étaient au chiffre de 100.000.
Dans tous les cas, ce phénomène des mères accompagnatrices nous révèle, en creux, les inégalités en défaveur des campagnes en matière d’études où les villes et les riches sortent invariablement vainqueurs. Il nous montre aussi la réaction des perdants dans cette éternelle course de fond : leurs efforts héroïques pour compenser le handicap et obtenir pour leurs enfants cette élévation sociale par le diplôme qui embellira l’avenir de leur clan. A y regarder de près, cette réactivité constatée en matière d’études se lit dans toutes les autres sphères de la vie courante chinoise - au travail, dans les mariages, au tribunal… C’est la fameuse énergie vitale, la « huoli » (活力), l’opportunisme pragmatique toujours prêt à récupérer et exploiter les opportunités pour faire mieux que survivre.
Elle pourrait constituer la meilleure définition de l’âme du pays.