


| Auteur | Fabio Viti |
| Editeur | Maison des sciences de l'homme |
| Date | 2023 |
| Pages | 495 |
| Sujets | Anthropologie Baoulé (peuple d'Afrique) Bandama, Vallée basse du (Côte d'Ivoire) Guerre civile Côte d'Ivoire Tradition orale Colonies Côte d'Ivoire |
| Cote | 68.141 |
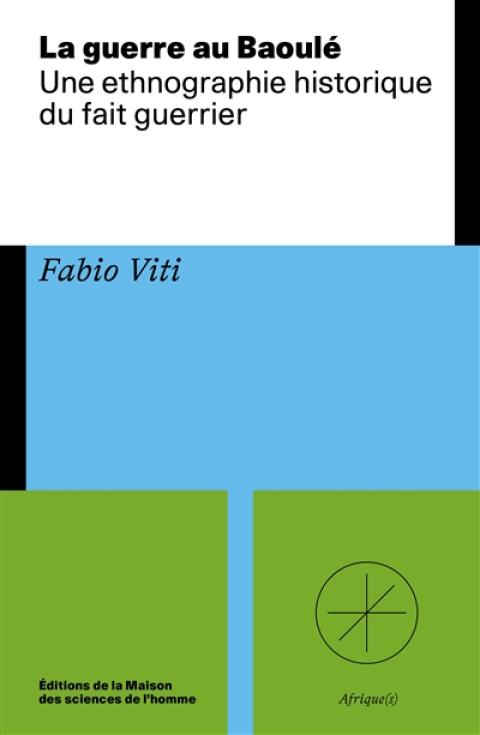
L’auteur nous propose, dans une optique rarement explorée, une somme de connaissances acquises au cours de nombreuses années au contact du monde baoulé, insistant sur de nombreux aspects de cette société, le travail, l’esclavage, les jeux, la guerre, et la conquête coloniale. Il a exploité les ressources d’enquêtes orales, consulté des archives écrites, sonores, matérielles, côté baoulé, les cartes, côté époque coloniale. A partir de cet ensemble, il a reconstitué les étapes du combat, l’état des forces en présence, la nature des affrontements, débouchant sur la question de la vie et de la mort.
Le livre se compose de deux grandes parties, l’une consacrée à la guerre baoulé, l’autre à celle des Blancs. Il s’achève par une longue présentation des sources orales (1986-2019), des sources imprimées, d’une riche bibliographie, ménageant une place de choix aux noms et aux auteurs baoulé. La démarche de l’auteur est explicitée dès l’introduction, avec la critique des documentations, du traitement de la mémoire, associant démarche historique et ancrage anthropologique, assurant le montage de traces hétérogènes lors du croisement des sources. Dans son étude, l’auteur est particulièrement sensible à la mise en résonnance de sources multiples. La guerre étudiée ici est une guerre à deux volets : guerre équilibrée, veillant au maintien de la société locale. Guerre d’agression étrangère à armes inégales, méconnaissant la souveraineté de l’ennemi.
Dans la première partie, l’accent est mis sur l’histoire des groupes qui s’installent au XVIIIe siècle entre Tiassale et Toumodi, entre forêt et savane, peu éloignés de la mer, qui entrent en contact avec des marchands, organisent un réseau de formations politiques localisées sous l’autorité d’un chef suprême secondé de dignitaires. L’ensemble de ces territoires formait un système cohérent.
Dès le XVIIIe siècle, les contacts terre/mer eurent un impact sur les habitants de l’intérieur, au moins par le commerce : acquisition d’esclaves, introduction d’armes. Toutefois, l’insécurité règne au début du XVIIIe siècle, entraînant de multiples guerres et marquant profondément les mémoires, donnant naissance à de nouvelles entités associant anciens et nouveaux occupants, variables selon les capacités d’assimilation des hommes. Une fois constitués, ces groupes se combattirent entre eux sous la direction de leurs chefs locaux, en vue de consolider mutuellement leur pouvoir, sans véritable enjeu territorial, en fonction de différents types de rivalités. Le commerce, l’orpaillage, pouvaient générer de nouveaux équilibres. On eut recours à différents stratagèmes dans cette recherche du pouvoir sur les hommes et sur la terre, dont la ruse. Au final, cette guerre d’assimilation gomma plus ou moins la mémoire des anciens occupants. Ainsi, à la fin du XIXe siècle, les deux groupes de partenaires se connaissent, et, dans le courant de ce siècle, cela eut pour conséquence de consolider la notion d’état. Ce fut une période complexe que l’auteur analyse avec finesse, au cours de laquelle les Baoulé furent en contact avec la mer, le trafic des esclaves, et, à la fin du XIXe siècle, avec Samory.
La conquête coloniale débute en 1893, s’achève en 1911. Elle fait l’objet de la seconde partie et apparait se dérouler en plusieurs épisodes, entraînant le déplacement des populations. L’auteur analyse les évènements qui sont alors arrivés aux N’gban, réputés très durs, bien connus de l’auteur. Des incidents, des pillages se produisirent au détriment des activités commerciales des convois entre Tiassalé et Toumodi. Des excès déclenchèrent une révolte de N’gban en 1894, puis s’installa une accalmie. Les années suivantes connurent une série d’évènements peu glorieux. Leur territoire devint territoire militaire, avec des opérations militaires planifiées secteur après secteur, s’accompagnant d’attaques quasi quotidiennes malgré le déséquilibre des armes, jusqu’à leur soumission en 1903.
A partir de 1904, s’établit un calme relatif, les Européens cherchant à remettre en état les habitations, les routes, à recenser la population. En 1908, le nouveau lieutenant-gouverneur de la Côte d’Ivoire voulut établir une nouvelle taxe de 5 francs, puis se livra à la saisie des armes déclarées provoquant une grande tension chez les habitants qui se livrèrent à des mouvements de résistance en 1910, pillant des colporteurs, menant des incursions contre les Dioula qui empruntaient la route Tiassale/Toumodi ainsi que diverses exactions. Ils se dressèrent contre les corvées, le portage, l’impôt. Alors fut envoyée une colonne de répression pour châtier les rebelles.
Les attaques furent organisées par le nord, le centre, le sud, détruisant des villages, employant des tactiques d’encerclement, pratiquant des attaques à l’arme lourde. Une fois privés de leurs chefs emprisonnés, les N’gban se retrouvèrent désarmés, désorganisés, les chefs furent déportés en Mauritanie, à Bingerville, au Sénégal. La démographie des N’gban touchés par une lourde amende en fut profondément modifiée. Les campements furent dispersés et étroitement surveillés.
Les Aïtou, de la neutralité à la collaboration active :
Nombre de M’vele Baoulé ont collaboré, mus par différentes motivations. Dès le début, certains s’opposèrent à la conquête. Il se produisit un premier soulèvement en 1894/1895, suivi par d’autres jusqu’en 1905. Les partisans Aïtou se portèrent au secours de Maurice Delafosse en 1899, après la dissolution de la colonne de Kong.
La répression des Agba : 1902, 195, 1910 : à l’ouest du N’zi, vers Dimbokro.
Les officiers français apprirent peu à peu à mieux connaître le terrain et ses habitants. Après un affrontement final, les villages purent se fixer et livrèrent leurs armes.
Blocus du poste de Saleckro par les Baoulé, puis reprise : 1902-1911 :
Le poste à la croisée de cours d’eau dans la forêt, entouré de villages, qui occupait une position pleine de ressources, placé sur un site défensif, entouré d’alliés, connut une phase difficile dont l’histoire est peu accessible lors des enquêtes menées par l’auteur qui a recouru aux sources coloniales : en 1902, les blancs du poste de Saleckro ont été arrêtés, marquant l’échec du contrôle du Bandama.
Il fut repris en 1911 après la prise de décision du lieutenant-gouverneur Angoulvant, d’après l’analyse du lieutenant Vix ; le 1er février 1911, le commandant Noguès lança l’offensive, voulant remporter la victoire à tout prix. Le village de Saleckro et sa région fut repris en cinq jours, grâce à la supériorité des armes, entraînant la mort de nombreux chefs baoulés. Les deux principaux chefs furent internés au Dahomey puis le poste de Saleckro fut supprimé.
Les faits sont narrés différemment : côté Baoulé, il s’est agi de l’abandon d’un lieu attaqué.
En fait, l’effacement mémoriel eut lieu des deux côtés. C’est ce qui ressort du travail de l’auteur qui a eu accès à la version de Nanafoué et aux sources militaires françaises.
Les Baoulé connurent de sévères répressions.