


| Auteur | Bé-Rammaj Miaro-Il |
| Editeur | l'Harmattan |
| Date | 2024 |
| Pages | 193 |
| Sujets | Sara (peuple d'Afrique) Tchad Histoire Sara (peuple d'Afrique) Moeurs et coutumes |
| Cote | 69.524 |
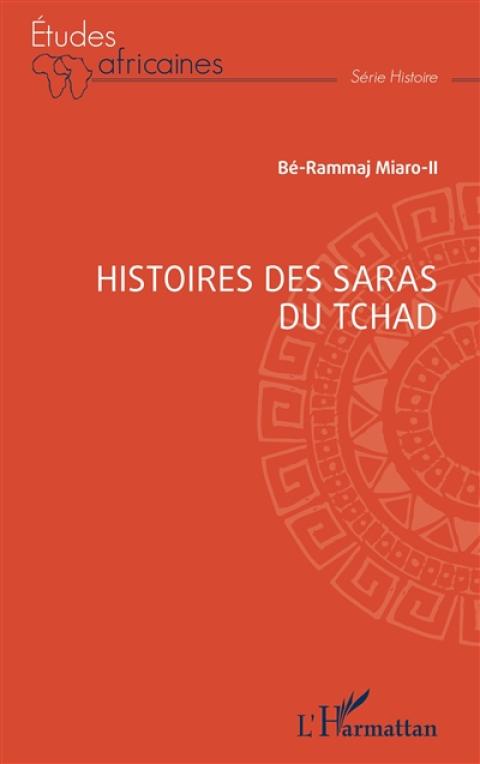
Les sociétés acéphales d’Afrique, dépourvues de pouvoir centralisé, ont suscité un fort intérêt chez les ethnologues et ceux-ci ont étudié leurs rites et leurs modes d’organisation. En revanche, l’histoire de ces peuples sans chef, dont les contours sont d’ailleurs souvent difficiles à saisir[1], a longtemps été jugée sans objet.
Les premiers travaux historiques ont été consacrés aux royaumes et grandes chefferies, groupes sur lesquels la conquête coloniale avait une prise plus assurée. Les sociétés acéphales posaient des problèmes plus ardus car leur soumission n’était jamais entièrement acquise. L’histoire de ces groupes que la vision évolutionniste de l’époque désignait comme « primitifs » apparaissait sans objet. En l’absence de structures spécifiques dédiées à la mémoire collective, leur passé est effectivement fort difficile à reconstituer et l’exercice relève nécessairement d’une ethnohistoire incluant rites et mythes. En établissant les ethnohistoires de ces peuples qui sont bien évidemment tout aussi historiques et modernes que les autres, des publications de plus en plus nombreuses leur font aujourd’hui justice. Bien que souvent marginalisés, ces groupes peuvent avoir une importance numérique notable dans les états modernes. C’est le cas des Saras qui constituent un tiers environ de la population du Tchad.
L’ouvrage en deux livres Histoires des Saras du Tchad de monsieur Bé-Rammaj Miaro-II est issu d’une conviction forte : « il faut que les générations montantes se mobilisent pour sauver ce qui reste des trésors laissés par leurs ancêtres » (p. 35) et de la découverte fortuite par l’auteur en 2015 de textes inédits issus des archives de l’Institut national tchadien pour les sciences humaines (INTSH) aujourd’hui fermé (p. 5).
En introduction, l’auteur récapitule brièvement ce qu’on sait aujourd’hui de l’histoire des Saras, peuple constitué de groupes arrivés dans la région au XVIe siècle parlant des langues qu’on rattache au groupe soudanique central et à la famille (hétérogène) nilo-saharienne.
Le premier livre, en cinq chapitres, est une Histoire orale de la sous-préfecture de Bébo-Pen dans la région du Mandoul, localité fondée au milieu du XVIIIe siècle dont la population est un mélange de Pen, de Bédjong, de Day, de Nar etc. La monographie rédigée par Bé-Rammaj Miaro-II, lui-même originaire de Bébo-Pen, se fonde principalement sur ses souvenirs d’enfance et sur les informations qu’il a recueillies auprès de dizaines d’informateurs très précisément présentés. Cette ethnohistoire inclut la succession des chefs et les circonstances détaillées de leur accession à une charge dont les changements au fil du temps sont également analysés (chapitre 2).
Les institutions de la société sont décrites ainsi que le rôle des autorités traditionnelles correspondantes (devins, prêtres de la pluie, de la terre et des initiations) ; ces personnalités sont nommément citées à partir d’informations recueillies sur place. Des éléments plus généraux issus d’un travail bibliographique introduisent ou éclairent ces données. Le recueil concerne Bébo-Pen mais aussi chacun des « gros villages » du canton (chapitre 3).
Les chapitres 4 et 5 font connaître l’essentiel du fonctionnement religieux et matériel des communautés villageoises : croyances religieuses ; fondation du village et intégration de nouveaux lignages ; mariages et naissances ; architecture et mobilier ; habillement ; techniques de l’agriculture, de la cueillette de la chasse et de la pêche. Une place de choix est donnée aux questions d’éducation et de transmission.
Le livre 2, Histoires des communautés Bédjonds, Sara Madjigays, Ngambays, et Day, élargit la focale avec des manuscrits inédits consacrés aux histoires des peuples de parler bédjond (département actuel du Mandoul occidental autour de Bediondo, Doba et Bodo), sara madjigay (vers Moundou), ngambay et day (sous-préfectures de Moïssala et de Koumra préfecture de Mandoul)[2].
Le premier chapitre (6, p. 111), Bédjondo et son peuplement par Madjadoum et Bandjim, relate l’histoire du peuplement de Bédjondo, actuellement chef-lieu du département du Mandoul occidental. La première partie intitulée Madjadoum (9 pages), s’ouvre sur la phrase : « l’histoire de la création de Bédjondo était racontée par Madjadoum à la radio Lotiko de Sarh (Fort-Archambault) »[3]. Bédjondo, fondé à la fin du XVIIIe siècle, était un puissant village-état avant d’être laminé par les razzias venant du Ouaddaï, du Barguimi et de l’Adamaoua, puis par la conquête coloniale française. La partie intitulée Bandjim Ketté Boy qui clôt le chapitre est la transcription d’un récit de vie oral d’un garde-forestier de ce nom, narration recueillie en 2015 alors que celui-ci avait 86 ans.
Le chapitre 7 (p. 125) Populations Saras et colonisation par le colonel Rhessa (7, 18 pages) présente un manuscrit du colonel Kagbé Rhessa Nguéna, dont la forme a été légèrement retouchée par l’auteur[4]. Ce militaire déclare qu’il faut recueillir des informations auprès des aînés par la méthode orale qu’il pratique lui-même et « effacer toute la fausse histoire écrite sur le sud du Tchad ». Voici deux exemples des corrections qu’il propose. Premièrement, l’origine des Gors et des Nganda étant unique, leur émiettement en divers groupes n’est dû qu’aux appellations coloniales. Ensuite, la mise en avant par le colonisateur d’une identité religieuse musulmane pour le Tchad est erronée car, bien qu’envahi par les Arabes, le peuple de ce pays avait gardé ses croyances négro-africaines traditionnelles. La transcription est illustrée par une carte des groupes sara et apparentés extraite de l’ouvrage de Joseph Fortier (1967)[5].
Le chapitre 8 (p. 147), Les Saras Madjigays, par Arap Joseph et Paul Raringar, est constitué de deux manuscrits inédits (légèrement retouchés par l’auteur[6]). Ils ont été rédigés par deux personnalités appartenant au groupe sara madjigaye, Joseph Arap et Paul Rarikingar. Ces textes « racontent les pérégrinations de leurs ancêtres dans le Soudan géographique avant de se fixer à Bédaya sur la rive gauche du Chari » (p. 145). Joseph Arap (p. 148), ancien directeur de l’enseignement primaire, relate la formation légendaire de l’« état sara madjigay » autour d’un roi dit Mbang au pouvoir uniquement religieux et en décrit l’organisation sociale et spirituelle. Il précise notamment que l’islam a eu peu de prise sur la population mais que c’est le christianisme (protestant) qui finit par faire reculer les croyances et la culture sara. Quelques aspects de celles-ci sont résumés (yondo, n’do, mariage etc.). Le manuscrit a été rédigé par Paul Rarikingar Tamadjita qui a été vice-président de l’Assemblée nationale, chef de canton de Balimba et enseignant en primaire de 1948 à 1950. Intitulé Histoire locale : Bédaya et ses Mbangs, Koumra et ses Ngarkoumras (p. 154), il donne notamment des généalogies précises et détaillées des chefs.
Le neuvième et dernier chapitreChefferies de Moundou et guerre de Bouna par sergent Roussel et Natoyoum Ph. (p.165) se fonde sur deux autres manuscrits. Celui du sergent Roussel, chef de la subdivision de Moundou en 1923, ville qui est aujourd’hui le chef-lieu de la région du Logone-Occidental et du département du lac Wey,s’intituleHistorique des chefferies de la subdivision de Moundou » et il est reproduit tel quel. Philippe Natoyoum, sur lequel Bé-Rammaj Miaro-II n’a pu obtenir aucune information, serait l’auteur de l’autre manuscrit dont la forme a été retouchée[7]. L’origine légendaire de Bouna (ville autrefois appelée Roura) est racontée et la mémoire orale de « guerre de Bouna » de 1928-1929 est rapportée. Bé-Rammaj Miaro-II (p. 24) estime qu’il s’agit d’« un témoignage très important de la situation très confuse créée par la concurrence entre Allemands et Français pour occuper cette partie du pays, et aussi par la violence des chasseurs d’esclaves ».
Le grand intérêt de l’ouvrage de Bé-Rammaj Miaro-II est de retracer l’histoire de diverses localités ou secteurs de la région sara à partir de témoignages locaux, ce qui est très précieux. De telles archives viennent compléter-et bien entendu contester-les écrits officiels.
On ne peut que se réjouir que des ressortissants sara donnent leurs propres versions des faits et présentent leur culture telle qu’ils la voient de l’intérieur.
Toutefois l’ouvrage présente certaines limites. Son organisation est quelque peu confuse : le résumé de la page 7 ainsi que le contenu de la page 145 qui est étonnamment insérée entre les chapitres 6 et 7 auraient dû être intégrés à l’introduction. Quand il était manifestement possible de le faire, les sources auraient dû être spécifiées avec plus de précision (chapitre 6). Une revue bibliographique plus approfondie aurait aussi pu donner la matière pour situer et commenter plus rigoureusement les documents présentés.
Ainsi, si les classiques sont bien mentionnés (Delafosse, Fortier, Jaulin, Magnant etc.), il n’a par exemple pas été tiré profit d’un article de Bernard Lanne[8] qui fait état d’une documentation locale assez abondante sur la guerre de Bouna[9]. Ces données auraient pu apporter plus de poids et d’intérêt au dernier chapitre.
Quelles que soient ses imperfections et limites, il faut saluer la publication d’un tel recueil « d’histoires » qui contribue à donner au peuple sara la visibilité et la reconnaissance qu’il mérite. Notons avec le colonel Rhessa (p.138) que les sociétés du sud du Tchad qui ont opposé « des guerriers intrépides aux esclavagistes baguirmiens et aux Foulbé ou Peuls, ainsi qu’aux troupes italiennes et nazies lors de la guerre 1939-1945 sont aujourd’hui au bord de la désintégration, après soixante ans de colonisation française suivie de la post-colonisation ! ».
[1] À ce sujet, voir Joseph Tandem Diarra, 2008. Et si l'ethnie Bo n'existait pas ?: Lignages, clans, identité ethnique et sociétés de frontières. Éditions L'Harmattan.
[2] Des cartes d’extension de ces parlers peuvent être trouvés dans l’Enquête sociolinguistique des variétés linguistiques de la Région de Doba du Tchad: Bebot, Bedjond, Gor et Mang , par Eric Johnson SIL International 2007. Une carte d’ensemble du pays sara est donnée dans l’article de Jean-Pierre par Magnant, 1981 : « Terres de lignage et État chez les populations dites ‘Sara’ du Sud du Tchad (XIXe-XXe siècles).Revue française d'histoire d'outre-mer, 68(250-253) 394-426.
[3] Madjhadoum étant décédé et l’auteur n’ayant pas eu accès à l’enregistrement sonore, ce dernier a rédigé cette parrtie d’après ses souvenirs et notes personnelles et d’après sa propre documentation écrite et orale (communication personnelle juillet 2025).
[4] Communication personnelle de Bé-Rammaj Miaro-II (juillet 2025).
[5] Le mythe et les contes de Sou en pays Mbaï-Moïssala, Paris, Julliard.
[6] Communication personnelle de Bé-Rammaj Miaro-II (juillet 2025).
[7] Communication personnelle de Bé-Rammaj Miaro-II (juillet 2025).
[8] Bernard Lanne, 1993. Résistances et mouvements anticoloniaux au Tchad (1914-1940). Revue française d'histoire d'outre-mer, 80(300), 425-442.
[9] Mémoires des élèves de l'E.N.A. du Tchad (Amos 1969; Bang Hombaye 1970; Boguel 1969; Djaïbé 1972; Djougal Abdoul Miraud 1971; Haroune Haltolna 1967; Jeudi René 1971; Kameldy 1965; Mbogo 1970; Mordjim 1972; Nassamadji 1969 ; Ndomnaïbaye 1970). Chronique rédigée par M. Nassamadji Palyo (15 février 1988).