


| Auteur | Fadi Georges Comair ; préface de S.E. le cardinal Béchara Rai |
| Editeur | l'Harmattan |
| Date | 2025 |
| Pages | 257 |
| Sujets | Maronites Liban Histoire Religions Relations Liban 2000-.... |
| Cote | 69.452 |
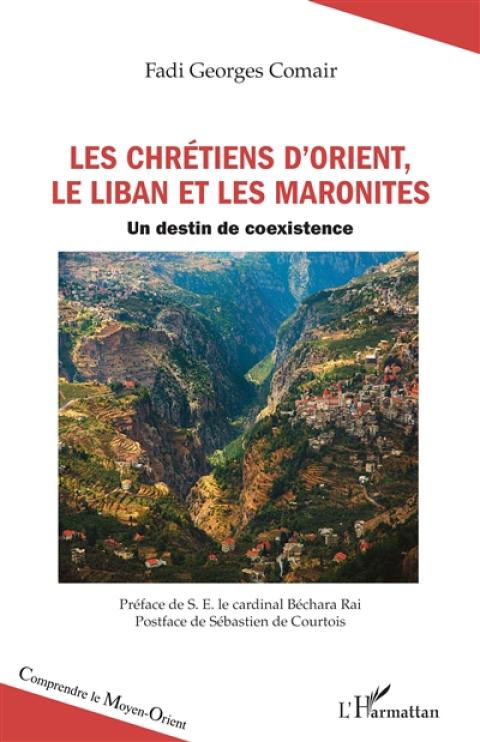
Notre éminent confrère, franco-libanais, né dans ce Moyen-Orient sans cesse sous pression politique, sectaire ou sécuritaire, nous propose son livre par passion pour l’histoire si enrichissante des premiers chrétiens d’Orient (p.15). Le sous-titre montre bien l’engagement de l’auteur à préserver le dialogue intercommunautaire.
Important de reconnaître, plaide l’auteur, que le christianisme a d’abord été une religion orientale avant de prendre son essor en Orient (p.67). Le monachisme y est né également dans le désert de Nubie et sur les rives de l’Oronte (p.68). Les évangiles de Luc, Marc et Mathieu rapportent les visites de Jésus à Tyr, Sidon et Cana, lieu de son premier miracle (p.181). L’Église maronite est le résultat du mouvement monastique émergé à Antioche après le synode chalcédonien (p.71). Saint Maron, mort en 410, vécut au Nord de la Syrie, prêchant l’éloignement du monde et l’ascèse (p.78). La grotte d’Hermel (p.93) servit de refuge aux disciples maronites qui fuyaient les persécutions (p.90). 77 Patriarches se sont succédé dans la Vallée Sainte et depuis Jean Al Haj à Bkerké (p.117). L’auteur consacre un chapitre aux saints libanais récents, Saint Charbel (1828-1898), universellement connu, et dont la tombe au monastère d’Annaya est un lieu de pèlerinage populaire et de guérisons spectaculaires (p.101), Sainte Rafqa (1832-1914), honorée comme modèle d’humilité et de dévotion (p.102), Saint Hardine (1808-1858), Saint Estephan Nehmé (1883-1938) et le Patriarche Estephan Douïehi (1670-1704) béatifié en 2024 (p.107).
Le 15 juillet 1919, le Patriarche maronite Elias Hoayek se rendit en France pour participer à la Conférence de la Paix, avec une délégation de toutes les communautés libanaises et le 1er septembre 1920 naquit l’État du Grand Liban d’une superficie de 10.452 km2 et comptant 414.000 habitants (p.131). Le 8 novembre 1943 avec le soutien des Présidents de la République et du Parlement, le Premier Ministre Riad Solh amendera la Constitution en supprimant toute référence au mandat français (p.136). Se succèderont ceux que l’auteur appelle « les Maronites Bâtisseurs », les Présidents Bechara el Khoury, Camille Chamoun (p.141), Fouad Chehab avec l’ensemble de ses décrets législatifs toujours en vigueur (p. 146 à 148). L’histoire retiendra que le seul âge d’or institutionnel que le Liban ait connu fut l’époque de la présidence Chehab de 1958 à 1964 (p.149), modèle de droiture et de lutte contre la corruption (p.23). La France continue d’aider le Liban, dernier bastion de la francophonie dans la région avec L’Institut français, l’AUF, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, quatre universités francophones, l’École Supérieure des Affaires et le réseau d’écoles et de lycées francophones (p.48).
Ingénieur de l’École nationale des ponts et chaussées (p.33), M. Comair avait été affecté en France au Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton, rattaché au Ministère de l’Équipement et de l’Industrie lorsqu’en mars 1993, le Premier Ministre Rafic Hariri lui demanda de prendre la direction des ressources hydrauliques au Ministère libanais de l’Énergie et de l’Eau (p.24). L’auteur défend le concept d’hydrodiplomatie qu’il a inventé et qu’il a pratiqué dans les négociations sur les bassins de l’Oronte en 2015 et du Jourdain en 2016 dans le cadre de l’UNESCO. En 2021, il assure la direction du Centre de recherche sur l’énergie, l’environnement et l’eau au Cyprus Institute (p.27).
Malheureusement, le Moyen-Orient chaotique et conflictuel est la proie des religions, des incompréhensions et des violences (p.49). Le fractionnement communautaire prôné par l’Empire ottoman eut pour conséquence que la religion devienne une identité territoriale (p.53) du fait que le concept de citoyenneté a échoué face à la religion et au communautarisme instauré par les puissances régionales (p.54). Au Liban, Yasser Arafat, soutenu par le KGB, avait déstabilisé le mandat du Président Charles Helou en faisant imposer par Nasser l’Accord du Caire qui paralysa le Gouvernement libanais (p.153). En 1968, la Révolution palestinienne avait réintroduit les clivages politiques entre les musulmans et les chrétiens (p.200), conduisant à la tutelle syrienne de 1976 à 2004 qui a pesé lourdement sur le Liban. L’auteur rappelle le massacre des chrétiens de la ville méridionale de Damour, effectué par les Palestiniens le 20 janvier 1976, au début de la guerre civile qui ébranla son pays durant quinze ans (p.19). D’autres massacres ont été perpétués dans la Bekaa, à Qaa, Ras Baalbeck et Jdeidat al Fakiha en juin 1978, villages occupés par les miliciens de Daech en 2014. En 2000, le Patriarche maronite Nasrallah Boutros Sfeir exigera le départ des Syriens conformément à l’accord de Taëf ; le mouvement estudiantin de l’Université Saint-Joseph, dès 1998, manifesta régulièrement dans ce sens dans les rues de la capitale (p.159). Il s’en est suivi une longue liste d’éliminations par la Syrie de jeunes Libanais compétents comme Dany Chamoun, Gebran Tueni, Samir Kassir,, Selim Lawzi, Loukman Slim, des officiers comme François El Haje, des religieux comme Cheikh Sobhi Saleh, des députés comme Pierre Gemayel, Antoine Ghanem (p.161). Quant à la libération du Liban de l’occupation israélienne, elle n’aura pas été durable en raison de la corruption de la classe politique libanaise et arabe (p.163). Le système politique en place continue d’œuvrer en faveur des intérêts personnels des dirigeants dont la stratégie est de promouvoir la loyauté à la communauté au détriment de la loyauté nationale. Le Liban connait aujourd’hui une période de vide politique et d’effondrement financier avec des incidents sécuritaires menaçant les Libanais de toutes les régions et augmentant la pauvreté (p.171). La terrible apocalypse du 4 août 2020 du port de Beyrouth a ravagé le cœur de la capitale, fait plus de 238 victimes et 6500 blessés et provoqué le déplacement de 300.000 familles sans que justice ne soit rendue (p 171). La dette publique de 90 milliards de dollars s’ajoute à la grande coupure qui sépare le peuple et les intellectuels d’une part et les décideurs politiques d’autre part (p.175).
Les Églises orientales isolées, exposées pendant douze siècles aux invasions, massacres, déportations, étaient devenues des conservatoires de la première piété chrétienne et de la dimension spirituelle du christianisme (p.119). Hélas, l’invasion américaine de l’Irak a transformé les six millions de chrétiens d’Orient en Irak et en Syrie en cibles à abattre comme suppléants de l’Occident surtout après l’auto-proclamation de l’État islamique en 2014 (p.44). Les 1,2 million de chrétiens en Irak en 2003 se sont réduits à 150.000 (p.45). Les radicaux de l’islam s’attaquent aux racines, à l’identité et au patrimoine des chrétiens d’Orient. Leur volonté suprématiste est menée au nom d’une interprétation erronée du Coran (p.196).
Le Liban doit renouer avec une politique de neutralité positive au lieu de celle des axes américano-saoudien ou irano-syrien qui ne lui a apporté que des entraves (p.215). Rappelons-nous la déclaration des Nations Unies lors de la session de septembre 2019 : « le Liban, Académie humaine pour le dialogue des religions et des civilisations » (p.222). Il faudra pour cela assurer l’exploitation des ressources pétrolières et gazières pour dynamiser l’économie et créer de nouveaux emplois (p.227). L’auteur développe dans le chapitre 20, les propositions d’une charte en 15 articles en vue de retrouver la paix et qui serait adoptée par le Vatican, les Églises orientales avec le soutien des Nations Unies et de la Communauté européenne (p.229), suivant l’exemple du Pape François et du Grand Imam d’Al Azhar, le Cheikh Ahmed El Tayeb, qui ont émis en 2019 un document sur la fraternité humaine à Abou Dhabi, appelant à la défense de la liberté de croyance et à la reconnaissance d’une pleine citoyenneté pour les minorités religieuses (p.41) .
Le lecteur consultera avec intérêt la bibliographie originale d’auteurs libanais et français sur ce sujet (p.249).