


| Auteur | Pierre Jacquemot |
| Editeur | Karthala |
| Date | 2024 |
| Pages | 219 |
| Sujets | Aliments Approvisionnement Afrique XXIe siècle Sécurité alimentaire Afrique XXIe siècle Souveraineté alimentaire Afrique XXIe siècle |
| Cote | 68.784 |
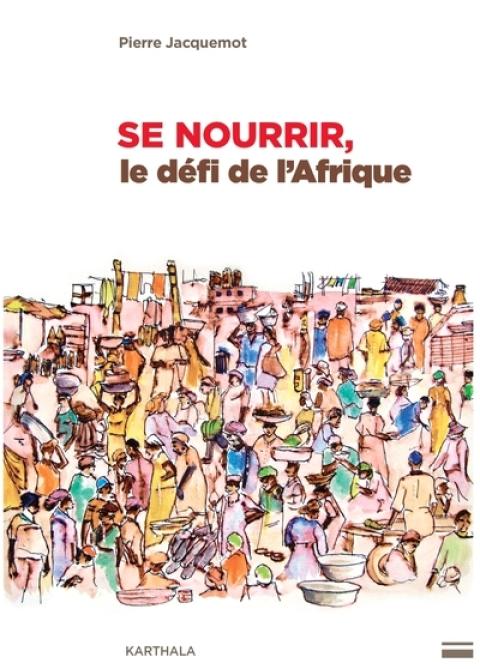
Cet ouvrage analyse ces deux thématiques que mentionne son titre, c’est-à-dire d’une part l’alimentation des populations du continent africain, y compris ses insuffisances, et d’autre part les voies de solution pour relever ce défi en mettant l’accent sur les filières de production locale et ce que cette ambition implique en termes d’innovations et de modes de faire.
Il est découpé en 13 chapitres, y compris une introduction, un glossaire et une bibliographie.
* L’introduction met l’accent sur la forte croissance de la demande alimentaire en Afrique, du fait de l’augmentation des populations, de la recherche d’une souveraineté continentale en ce domaine ainsi que de la résilience de celle-ci malgré les risques et défis qu’elle affronte.
A ce titre il est précisé que les réflexions porteront sur :
- les tendances qui façonneront l’avenir de ces systèmes alimentaires ;
- les germes de changement et d’évolution dans les tendances en question ;
- les agents de tous ordres susceptibles de mettre en œuvre les transformations nécessaires pour ce faire ;
- les options agronomiques, techniques et financières associées à cela ;
- les réponses aux enjeux démographiques et spatiaux du fait de l’urbanisation ;
- les outils permettant de traiter les chocs de tous ordres qui menacent les systèmes alimentaires.
* Un premier chapitre passe en revue ces multiples défis et donc l’absolue nécessité d’avoir et de mettre en œuvre des scénarios volontaristes pour y faire face.
* Un deuxième chapitre décrit les mutations en cours dans les sociétés rurales en Afrique, notamment en ce qui concerne les savoirs traditionnels autochtones.
* Un troisième chapitre passe en revue les diverses options déjà mises en œuvre ou envisagées pour relever les défis auxquelles sont confrontées ces activités, en mettant un accent sur l’agro-écologie.
* Un quatrième chapitre traite des multiples formes du système foncier et de ses évolutions, ainsi que de la question des semences.
* Un cinquième chapitre déroule les innovations de divers ordres, notamment dans les domaines de la recherche, des engrais, des outils de vulgarisation pour les diffuser en innovations, ainsi que des modalités d’association entre l’agriculture et l’élevage.
* Un sixième chapitre détaille les innovations dans les technologies, en particulier afin de réduire des vulnérabilités de tous ordres, notamment climatiques.
* Un septième chapitre est également positionné sur les innovations, mais ici sur les modes de financement des activités dans le monde rural.
* Un huitième chapitre traite de la question de l’élevage et cela sous ces quatre angles que sont l’articulation avec les activités agricoles, les contraintes environnementales, la donne démographique et l’impact de l’urbanisation sur les modes de consommation.
* Un neuvième chapitre cible les ressources halieutiques, fortement menacées par la surexploitation, notamment étrangère et de type industriel.
* Un dixième chapitre est centré sur le monde urbain dans de multiples dimensions, comme le confortement d’un continuum rural-urbain, le développement de l’agriculture en ville ou dans sa périphérie, les divers modes de commercialisation des produits ainsi que l’évolution des modes en question.
* Un onzième et dernier chapitre détaille ce que sont, ou devraient être, les orientations des politiques publiques afin de relever ces innombrables défis et réduire les risques qui pèsent sur la sécurité alimentaire en Afrique.
Un glossaire en fin d’ouvrage donne sens aux termes et expressions utilisés.
Quant à la bibliographie, elle cite les 78 sources sur lesquelles s’est appuyé l’auteur de ce livre.
Cet ouvrage est doublement ambitieux.
D’une part il aborde, sans exception aucune, toutes les problématiques relatives à la situation alimentaire des populations sur le continent africain, c’est-à-dire la demande et les diverses modalités de l’offre pour y faire face.
D’autre part il passe en revue, sur le temps court et le temps long, les évolutions en cours dans ces deux domaines et pour cela s’appuie sur une impressionnante collection de témoignages et de documents scientifiques.
La question qui reste en quelque sorte pendante, notamment en termes d’innovation des modes de faire et de leur mise en œuvre effective est celle de leur ampleur, c’est-à-dire du passage depuis des innovations incontestables vers des processus d’évolution à grande échelle afin de répondre au double défi de nourrir l’Afrique et d’en faire un outil central pour le développement économique et social du continent.