

| Auteur | Perig Pitrou |
| Editeur | Presses Universitaires de France |
| Date | 2024 |
| Pages | 535 |
| Sujets | Anthropologie Écologie humaine Biopolitique Ethnologie XXIe siècle |
| Cote | 69.079 |
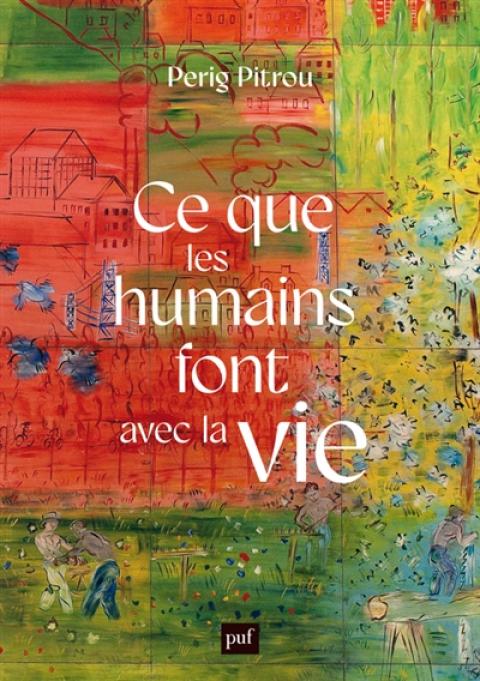
Anthropologue, directeur de recherche au CNRS et responsable de l’équipe « Anthropologie de la vie » à l’université PSL, Perig Pitrou fait le point, avec Ce que les humains font avec la vie, d’années de recherches et de réflexions sur le sujet hautement symbolique du « vivant » et de la « vie », de leurs relations, de leurs pouvoirs, de leur intrication. Convoquant un grand nombre de disciplines, l’auteur met en lumière les acquis des chercheurs antérieurs et ouvre la voie à de nouvelles pistes de réflexion.
Après un « Avant-propos » dédié à l’évocation des auteurs et des études qui ont compté dans la rédaction de cet essai, l’ouvrage s’ouvre par une « Introduction » dense, dans laquelle P. Pitrou définit ces axes de réflexion, précise les thèmes et le vocabulaire utilisé, tout en abordant déjà le cœur du sujet.
L’ouvrage est construit autour de trois grandes parties - « Vie en société » ; « Méthodes » ; « Cosmobiopolitique » - qui vont être détaillées et approfondies au fil de neuf chapitres, permettant au lecteur de s’immerger de plus en plus intensément dans les concepts abordés par l’auteur et ses prédécesseurs.
La vie est en effet un concept aux contours flous et mouvants, selon l’angle de vue adopté ; l’auteur en tire de premières questions : « Qu’est-ce que la vie ? Qu’est-ce qu’être vivant ? », auxquelles il va proposer des réponses tout au long de ces 536 pages. La première partie sera consacrée à l’établissement d’un cadre commun, un essai de classification du vivant selon des définitions les plus englobantes possibles, tout en évoquant l’apport de la science ethnologique pour dépasser le cadre biologique : de fait, le vivant peut être intégré dans différentes entités conceptuelles, selon les populations, les usages et les interventions des métapersonnes - terme utilisé par l’auteur, pour son amplitude, afin d’évoquer des déités omnipotentes, invisibles et actives, non obligatoirement anthropomorphes. Les rituels (techniques) pour demander l’intercession des métapersonnes afin de faire pousser les cultures ou faire tomber la pluie ; la procréation en termes biologiques et métaphysiques ; les liens de parenté au sens biologique - la paternité au temps de l’insémination artificielle - ou ethnographique - partage du foyer, de l’âtre, du repas - ou le sens de la famille, sont les premiers sujets auxquels va se confronter l’auteur. La notion d’« une vie », en parallèle à celle de « la vie », est intensément discutée, notamment sous le prisme du concept de la réincarnation qui promeut « la vie » dont le cycle de réincarnation est issu, à l’opposé d’« une vie » individuelle. Pour finir et en filigrane du premier chapitre « Penser la vie », un constat s’impose pour tous, celui des limites et de l’évolution de la vie, commençant par la naissance, puis le développement, la procréation et, de manière fatidique, s’arrêtant avec la mort. Pour définir son domaine d’étude et en s’appuyant sur les études d’Arthur Hocart - présenté par P. Pitrou comme le père de l’anthropologie de la vie -, celle-ci peut être envisagée comme une entité à part, « qui va et vient ». Pour obtenir cette entité, des rituels seraient mis en place - rituels désignés sous le terme de « techniques ». Ces techniques composeraient la « science de la vie » et la technique elle-même « science appliquée de la vie ». La science du concret (Lévi-Strauss), quant à elle, consisterait en la science enchâssée dans l’empirisme, l’observation et la pratique, avant la science moderne.
En découlent les questions suivantes : que font les humains lorsqu’ils mettent en place des « techniques du vivant », telles que l’élevage, l’agriculture, la chasse, la pêche ou les activités thérapeutiques utilisées pour interagir avec les organismes ? Comment décrire ces techniques ? Ce sont ces réflexions qui retiendront le lecteur dans le deuxième chapitre, « Agir avec les techniques ». L’emploi, par l’Homme, d’un casse-noix pour extraire le cœur du fruit, montre par l’exemple qu’il y a une socialisation de la vie, c’est-à-dire une technique pour amener les organismes à répondre aux besoins et buts des humains. La « nature » (la biologie) a un pouvoir indispensable, mais les rituels et la magie « calibrent ce pouvoir afin de le faire correspondre à l’objectif humain ». Les techniques du corps (apprentissage) tout comme l’action outillée (usage d’artefacts) prouvent la présence d’une agentivité dans tout : « Le potentiel d’action d’un corps dépend des outils qu’il manie, la fonction de ces outils est indissociable de leur emploi, les mouvements des corps et la fabrication des objets gardent la trace de l’influence des milieux, mais en retour ces derniers les transforment. » Dans certains cas, les objets et artefacts eux-mêmes deviennent vivants, d’autant plus s’ils ont été façonnés avec des éléments vivants (animaux, arbre). Ces fétiches, pourtant construits par l’humain, deviennent des entités à part, vivantes, déléguées des pouvoirs d’une métapersonne. Ils doivent en cela être protégés, vêtus, nourris, etc. En désaccord avec les conclusions de Tim Ingold - selon lequel il n’y a pas vraiment de distinction entre faire/fabriquer et faire croître/cultiver, les deux cas présentant non une transformation, mais une croissance - P. Pitrou s’adosse sur cette divergence pour établir ses théories. Son étude s’appuie sur les chaînes opératoires, c’est-à-dire les combinaisons d’actions exécutées par les humains et les non-humains qui vont permettre aux techniques d’exister. La relation entre making et growing (fabrication et culture) est alors un prolongement avec une complexification : l’activité technique hybride les processus vitaux, par l’intervention humaine et des métapersonnes.
Dans le chapitre 3 « Faire société avec la vie », le chercheur constate que les humains ne font pas tout ce qu’ils peuvent (techniquement) faire avec les êtres vivants. Ils sont soumis à des règles, des préjugés, des interdits ; autant d’« institutions » qui régissent leurs actions. Ces institutions ne sont pas fixes, elles évoluent avec le temps, selon les besoins de la collectivité. Trois grandes institutions sont dégagées : celles relevant de l’économie politique de la vie ; les institutions sociopolitiques organisant les collectifs - ritualisation de la conception, de la mort - et les royautés sacrées. Ce chapitre présente les travaux de plusieurs chercheurs en anthropologie, ainsi que de nombreux exemples. P. Pitrou conclura cette thématique avec les théories de Marshall Sahlins qui fait de la vie un point pivot, un centre autour duquel tournent les collectifs et la réflexion en anthropologie sociale.
Pour ouvrir sa deuxième grande partie « Méthodes », l’auteur propose l’idée de faire des collectifs de scientifiques en charge des questions biotechnologiques sur la vie (cellules souches, greffes d’organe, procréation assistée, clonage, etc.) un sujet d’étude de l’anthropologie de la vie ; il en dégage des traits directeurs (parenté, rites, organisation sociale), mais constate l’absence ou le flou des métapersonnes. Illustrant son propos avec les travaux de Stefan Helmreich, il en déduit que la « vie » peut être au centre des études, mais renvoyer dans chaque cas à un concept différent ; il reste cependant un lien évident entre le concept et les biotechnologies disponibles au moment de la formation du concept - « La théorisation est influencée par le contexte sociotechnique et en retour, la reformulation des théories de la vie transforme les pratiques, allant parfois jusqu’à réformer les institutions. » La vie devient ainsi une technique, dans laquelle il reste cependant une dimension vitaliste : « L’animation d’un fragment d’organisme est indissociable d’un regard, d’un corps, d’un esprit, bref, d’un être vivant qui cherche à appréhender le phénomène » (p. 233), une activité scientifique combinant inférences intellectuelles et engagements émotionnels et perceptifs. Dans cette partie consacrée aux laboratoires, les métapersonnes ne sont pas évoquées, mais l’idée de « Nature » est bien présente, renvoyant à des pouvoirs que les humains ne possèdent pas en propres : « Jusqu’à preuve du contraire, [les humains] ne possèdent pas le pouvoir de vie, c’est-à-dire la capacité de fabriquer des êtres vivants à partir d’éléments de la matière inanimée. » Ce qui n’empêche pas certains collectifs de se prendre pour des « mini-dieux », aux motivations plus ou moins mercantiles ou éthiques.
Ayant ainsi dégagé les similitudes entre l’ethnographie de laboratoire et l’ethnographie des sociétés traditionnelles et montré que les STS (Science and Technologies Studies) étudient les mêmes objets que l’anthropologie - elles prennent en compte toutes deux la subjectivité des observés et des observants - l’auteur affirme qu’« il faut à présent relever le défi d’un comparatisme entre sociétés très dissemblables, après avoir évalué des « comparables » ». Cette réflexion montre cependant un incontournable : la possibilité d’agir sur le vivant modifie le partage des pouvoirs entre métapersonnes et humains, ces derniers abusant de leurs possibilités jusqu’à avoir un effet délétère et destructif sur les milieux de vie et fragilisant la vie humaine elle-même.
Dans son chapitre sur « « Écologies de la vie », Perig Pitrou relie son sujet d’étude avec des considérations particulièrement contemporaines : le lien entre le vivant et le milieu. Après une mise en garde pour ne pas se contenter d’un fantasme de connexion avec la Nature, il va critiquer les travaux de Ingold, de Kohn et de Tsing qui ont, selon lui, glissé vers la métaphysique sans cadres anthropologiques et ethnologiques rigoureux. La conclusion qu’il dégage, exemples à l’appui, est qu’une collaboration est possible entre anthropologie sociale et écologie, entre écosystème et système social. L’idée de la prédominance de la Nature sur l’être humain ou, à l’opposé, celle de l’humain sur la Nature, peut et doit être dépassée.
« La vie dans les mots » est sans doute l’une des parties les plus intéressantes de l’essai, dans ce qu’elle renvoie à la personnalité et au vécu du lecteur ; car si l’anthropologie de la vie prend comme objet d’étude les corrélations entre théories, techniques et institutions, il ne faut pas pour autant oublier un item : les humains qui font l’expérience de situations concrètes. Sans laisser de côté la dimension objective et collective, l’anthropologie du vivant doit également donner une place aux investigations sur l’expérience de vivre : que fait la vie aux humains, en quoi notre vitalité (notre mortalité) façonne notre manière d’être humain ? Que font les humains avec la vie ? Quelles sont les caractéristiques proprement humaines qui donnent aux humains cette manière spéciale d’expérimenter leur place dans l’univers ? Le propos s’attardera ainsi à présenter les relations de pouvoir (violence, guerre, mauvais traitements) ; la place de l’anthropologue dans la méthodologie qui ne le rend plus neutre ; et surtout des récits de vie, forts intéressants, liant l’individuel et le collectif, la culture et la société. Documenter des récits de vie, souvent tragiques, ne rend pas l’anthropologue porte-parole des victimes, car ces enquêtes révèlent aussi des actions, individuelles et/ou collectives, visant à résister à la dissolution des formes de vie, à les établir sur des bases plus humaines ou à dénoncer des inégalités et revendiquer des droits. Les travaux de Didier Fassin évoqués dans ces pages donnent un éclairage sur la politique de la vie et la biopolitique : l’anthropologie biopolitique vise à agréger des contextes ethnographiques, des savoirs médicaux et des analyses textuelles, car la compréhension multifactorielle des vies humaines est indissociable de la description de leur milieu, écologique et sociopolitique. En conclusion, l’auteur soulève l’importance d’un renouvellement de l’approche en termes de « récits de vie » : le fait d’être en vie et de risquer de ne plus l’être est un déterminant de la manière de raconter une existence humaine qui varie selon les façons de penser, les époques, les milieux… Reste que l’efficacité pragmatique de ces discours dépend d’un cadre institutionnel qui détermine les raisons de produire des récits de vie et leurs règles de construction (déclaration, demande d’aide, etc.).
Après avoir défini l’objet de l’anthropologie et les méthodes disponibles pour l’étudier - à travers les quatre grands courants de la vie en société que sont les STS, l’anthropologie de l’ordinaire, l’anthropologie de la biopolitique et l’anthropologie de l’écologie -, l’auteur affirme la complémentarité de ces approches : cette troisième et dernière partie démontre comment une problématisation autour des relations entre vie et politique peut être féconde.
L’anthropologie de la vie présentée par l’auteur se positionne autour de la notion de biopolitique, fruit des enquêtes ethnographiques et des notions biotechnologiques. Il propose, pour aller plus loin, une approche cosmobiopolitique qui intègre les investigations des quatre courants anthropologiques, en élargissant la sphère politique aux non humains (rôle des animaux, des végétaux, des artefacts, des éléments du paysage dans les collectifs) ainsi que les moyens mis en œuvre par les humains pour coordonner leurs actions avec l’agentivité des entités exerçant les pouvoirs de la vie et qui influent sur l’ordre sociopolitique.
Cet élargissement du domaine des études permet ainsi de revenir sur le thème de la puissance de la mort, du pouvoir artificiel des souverains, de la violence exercée par des individus sur d’autres êtres ou sur eux-mêmes, de l’implication de l’État (ou son absence) dans la vulnérabilité humaine, et surtout d’aborder la notion de Care.
La notion de Care, dans laquelle les citoyens deviennent des acteurs en termes individuels et collectifs, motivés par des interactions réciproques - aider, prendre soin, coopérer -, a engendré une politique du Care, issue des théories féministes et qui s’applique principalement dans le domaine médical. L’idée est de sortir d’un rapport gouvernant/gouverné ou médecin/patient, pour partager le pouvoir dans un acte de réciprocité. Le Care s’applique également à l’intention des métapersonnes et dans les relations avec l’environnement. La reconnaissance de la vulnérabilité des vies humaines et des écosystèmes où les excès du capitalisme offrent peu de protection, incite à chercher d’autres voies. La reconnaissance de la vulnérabilité suscite des dynamiques de mobilisation dans lesquelles le soin pour les non-humains s’accompagne d’un engagement pour construire des relations politiques sur des nouvelles bases, par l’invention de nouveaux moyens de traduire l’interdépendance entre les vivants sur des principes politique de solidarité. « Le défi, à l’heure de l’Anthropocène, est de passer d’une « nécropolitique » à une « symbiopolitique », c’est-à-dire de passer d’une relation destructrice avec le vivant à des formes de cohabitation plus harmonieuses pour tous les êtres de la planète. »
Par l’amplitude des concepts, théories, travaux, références abordés, l’essai de Perig Pitrou se veut en premier lieu un ouvrage universitaire à destination des spécialistes, tant le matériel documentaire est fourni. Malgré son souci pédagogique, qui se manifeste par des répétitions et des références croisées, la densité du propos alliée à un vocabulaire érudit rend l’approche de Ce que les humains font avec la vie difficile pour le lecteur non expert. Cependant, certaines parties vont bien au-delà sans doute du dessein originel de l’auteur : tout lecteur, de par son statut d’être vivant, ne pourra que se questionner sur sa conception personnelle de la vie, de ce qu’être en vie signifie pour lui, de ce qu’il veut faire de sa vie et, finalement, de s’interroger : est-ce que je mène une « bonne vie » ?
Riche d’une bibliographie imposante, l’essai de Perig Pitrou arrive à point nommé pour élargir la science anthropologique de la vie, par sa critique des études passées, par ses propositions d’études à venir, et surtout dans sa perceptive contemporaine d’intrication entre le « naturel » et le « technique » et sa prise en considération des entités non humaines.